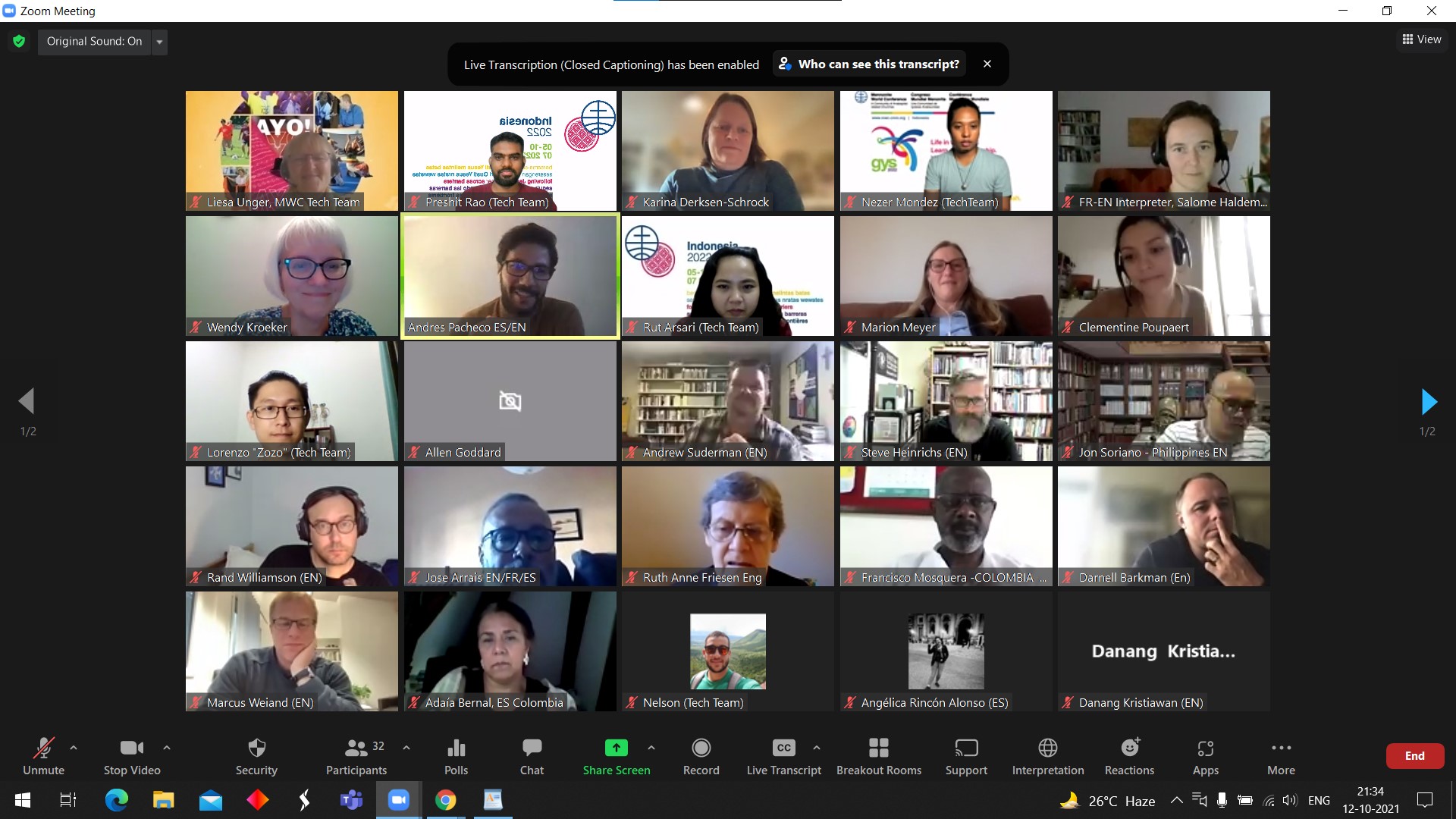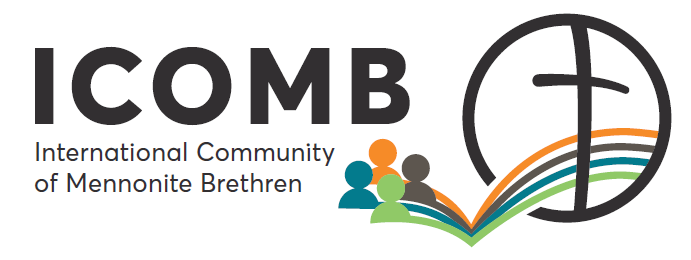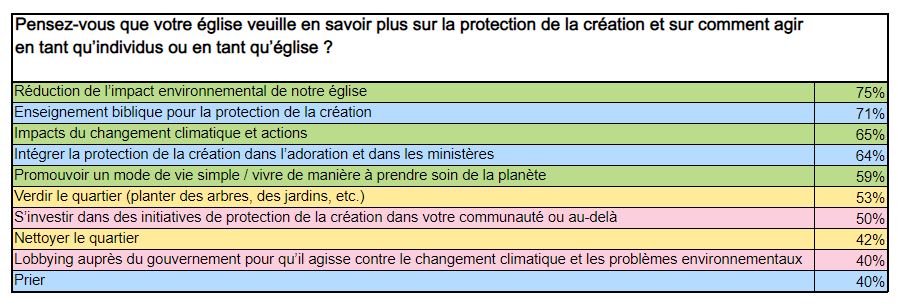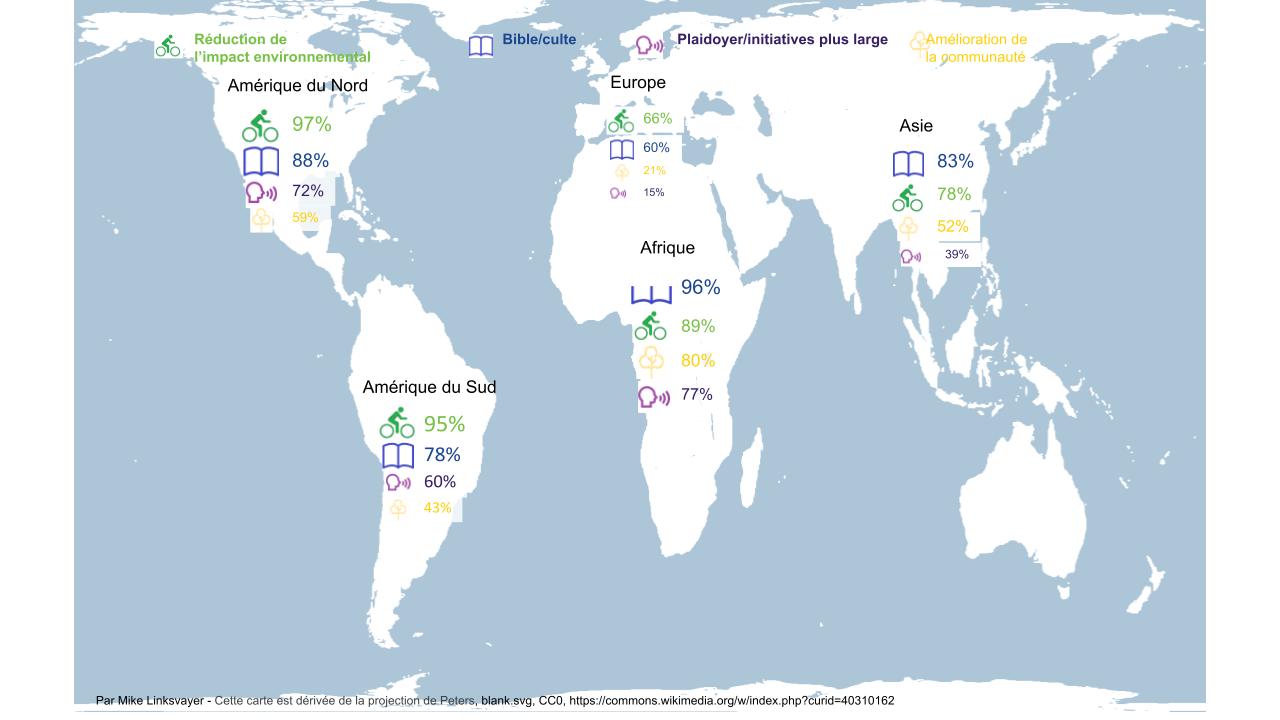Comment Dieu révèle-t-il la gloire de Dieu à l’humanité ?
1. Dans l’univers
Avec le psalmiste, les disciples de Jésus confessent, le cœur rempli d’admiration, : « Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame son ouvrage. » (Psaume 19/1). Les disciples de Jésus exaltent la grandeur de Dieu: « SEIGNEUR mon Dieu, tu es grand » (Psaume 104/1b).
Dans le Psaume 104, le psalmiste exprime son admiration pour la majesté divine qui transparaît dans la nature, même si le poète l’exprime avec le langage de la mythologie et de la cosmologie. Pour le psalmiste, la variété des créatures qui remplissent la terre manifeste la sagesse de Dieu. Son admiration pour la gloire de Dieu le pousse à se réjouir en Dieu (v. 34). Il veut même que Dieu se réjouisse de tous les fruits de son œuvre (v. 31). Lorsque la gloire divine, c’est-àdire la majesté et la sagesse de Dieu, remplit le cœur des croyants, les disciples de Jésus se réjouissent en Dieu. De plus, ils veulent s’unir à la joie de Dieu pour toutes les œuvres divines qui ont révélé sa gloire.
Ainsi, pour les disciples de Jésus, l’univers est le theatrum gloriae dei, la scène qui présente la gloire de Dieu, comme l’a dit Jean Calvin, un des premiers théologiens réformés.
2. Par Jésus-Christ
Le disciple de Jésus comprend que JésusChrist est la Parole faite chair. Par la Parole, Dieu a fait toutes choses (Jean 1:3) ; les cieux et la terre et tout ce qui s’y trouve (Genèse 1/1-2/4a). Puis le Verbe s’est incarné, s’est fait chair en Jésus-Christ (Jean 1/14). Celui qui était « au commencement » (Jean 1/1) et « au commencement était avec Dieu » (Jean 1/2), jouit de la communion la plus profonde avec Dieu (Jean 1.18). Jésus est venu dans le monde sous forme humaine pour “interpréter” Dieu (Jean 1/18) pour l’humanité, c’est-à-dire pour révéler le cœur de Dieu aux êtres humains.
Toute la vie de Jésus révèle que Dieu est prêt à être Père/Mère/Parent pour les êtres humains. Par sa volonté de devenir Père/Mère, Dieu révèle sa grâce et sa vérité à l’humanité dans la vie de Jésus, faisant des êtres humains des enfants de Dieu. Celui qui accepte Jésus-Christ devient enfant de Dieu. Quiconque croit au nom de Jésus sait avec certitude que Dieu est devenu Père/Mère. La gloire de Dieu, révélée en Jésus, invite chacun à expérimenter la grâce de Dieu et cette vérité que Dieu est complètement digne de confiance.
3. Par l’Église.
Fondée sur la victoire du Christ (par sa mort et sa résurrection) sur les puissances et les principautés, l’Église est le moyen dont JésusChrist vit dans le monde d’aujourd’hui. Le Christ, qui « est monté au ciel et s’est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant » pour régner en tant que Messie, n’est plus physiquement présent dans le monde. Selon le plan de Dieu, Jésus est présent à travers l’Église, qui est « son corps » (Éphésiens 1/23), c’est-à-dire la représentation du Christ ou le signe de la présence du Christ dans le monde.
Par l’intermédiaire de l’Église, le Christ continue de « prêcher la paix » (Éphésiens 2/17 ; Éphésiens 6/15), il proclame aussi la victoire sur les puissances du monde (Éphésiens 3/10), sur les structures qui causent l’exploitation, l’oppression, la marginalisation des êtres humains, voire le pillage et la destruction de la nature !
Sociologiquement, l’Église, que l’on appelle le Corps du Christ, est une communauté. L’église est une communauté composée de personnes qui, par la foi (et le baptême des croyants) ont consacré leur vie (et leur mort) à Jésus-Christ. Il est remarquable que le Christ se présente au monde à travers « un aspect le sociologique ». Comment cet « aspect sociologique » peut-il représenter le Christ dans le monde, être signe de sa présence, accueillant le monde avec paix, et proclamant sa victoire sur les puissances ? La réponse est : par l’œuvre du Saint-Esprit.
Jésus-Christ, le Messie, a déversé son Esprit pour fortifier l’Église. Tout d’abord, en union avec le Christ, chaque croyant ou disciple du Christ est uni aux autres. L’unité a une forme concrète, à savoir une communauté : c’est l’église ou l’assemblée locale. Puis le Saint-Esprit, qui vit en chaque disciple du Christ et est présent dans l’Église :
- nous forme selon le caractère de Christ (Galates 5/22-23a);
- donne les dons spirituels pour servir et s’édifier les uns les autres (1 Corinthiens 12/3-13) ; et
- produit l’amour, la sagesse et le courage pour prêcher l’évangile de paix et pour vivre authentiquement, libéré par le Christ des pouvoirs qui exploitent, oppriment et marginalisent (Éphésiens 3/10; 6/15; 2 Timothée 1/7).
De toute évidence, le Saint-Esprit donne à l’Église le pouvoir de vraiment représenter le Christ dans le monde, d’être un signe de la présence du Christ qui accueille le monde avec paix et annonce la victoire du Christ sur les puissances. Jésus lui-même a appelé ses disciples « la lumière du monde », « la ville sur la colline » et « la lampe sur le chandelier » (Matthieu 5/14-15). Grâce aux œuvres magnifiques accomplies ensemble par les disciples de Jésus dans l’Église, beaucoup glorifient Dieu, leur Père.
C’est ainsi que nous comprenons ces « œuvres magnifiques » : fortifiée par l’Esprit Saint, l’Église proclame l’évangile de paix, et les chrétiens peuvent vivre authentiquement, ayant été libérés par le Christ des puissances qui exploitent, oppriment et marginalisent. La gloire de Dieu est ainsi révélée.
Tout aussi important, nous croyons qu’en Christ, le dessein de l’appel de Dieu à Abraham est accompli. Dans l’histoire d’Abraham (Genèse 12-25), nous voyons que Dieu lui a promis trois choses : une descendance, une terre et une communauté. Ces trois promesses ont un seul but : qu’Abraham et ses descendants soient une bénédiction pour tous les peuples de la terre. Nous retrouvons ces trois promesses et le même dessein dans l’histoire d’Isaac (Genèse 26-27) et l’histoire de Jacob (Genèse 28-35).
L’apôtre Paul affirme qu’en Christ, la promesse d’une postérité pour Abraham est accomplie, et la bénédiction d’Abraham s’est étendue aux Gentils (Galates 3/14,16). Partout dans le monde, nous recevons cette bénédiction, qui consiste à devenir enfants d’Abraham et enfants de Dieu, « par la foi en Jésus-Christ ». Les implications sont très importantes. Comme nous le lisons dans Galates 3/26-28, dans l’Église, il n’y a plus de racisme (« ni juifs ni grecs »), plus de distinctions de classe (« ni esclaves ni indépendants ») et plus de sexisme (ni homme ni femme). Tous sont unis à ou en Christ par le Saint-Esprit par le baptême. Tous sont enfants d’Abraham et enfants de Dieu.
Tous ensemble, nous sommes frères et sœurs – égaux – appelés à nous aimer et à nous servir les uns les autres, et à construire l’Église. Avec l’aide du Saint-Esprit, nous travaillons ensemble pour en faire une réalité, afin qu’il n’y ait réellement pas de racisme, de différence de classe ou de sexisme dans l’Église. C’est un exemple de vie authentique de personnes libérées par le Christ des pouvoirs qui exploitent, oppriment et marginalisent. C’est le témoignage de la « communauté des personnes libres » de la victoire du Christ sur les puissances ! Cela rend la prédication de l’Évangile de paix significative et percutante, car elle a le poids « des paroles et des actes ».
La vérité concernant l’Église, qui est au cœur de la pratique de suivre ensemble Jésus, est la vérité sur la révélation de la gloire de Dieu. Dieu a révélé la gloire de Dieu à l’humanité dans l’univers, par Jésus-Christ, et par l’Église, qui est la communauté des disciples de Jésus, c’est-àdire nous – nous qui suivons ensemble Jésus !
—Rudolfus Antonius (Pdt. Rudiyanto) est le pasteur de laparoisse GKMI (Gereja Kristen Muria Indonesia) à Yogyakarta.
Matériaux du dimanche de la fraternité Anabaptiste mondiale
#AnabaptistWorldFellowshipSunday #mwcmm #awfs