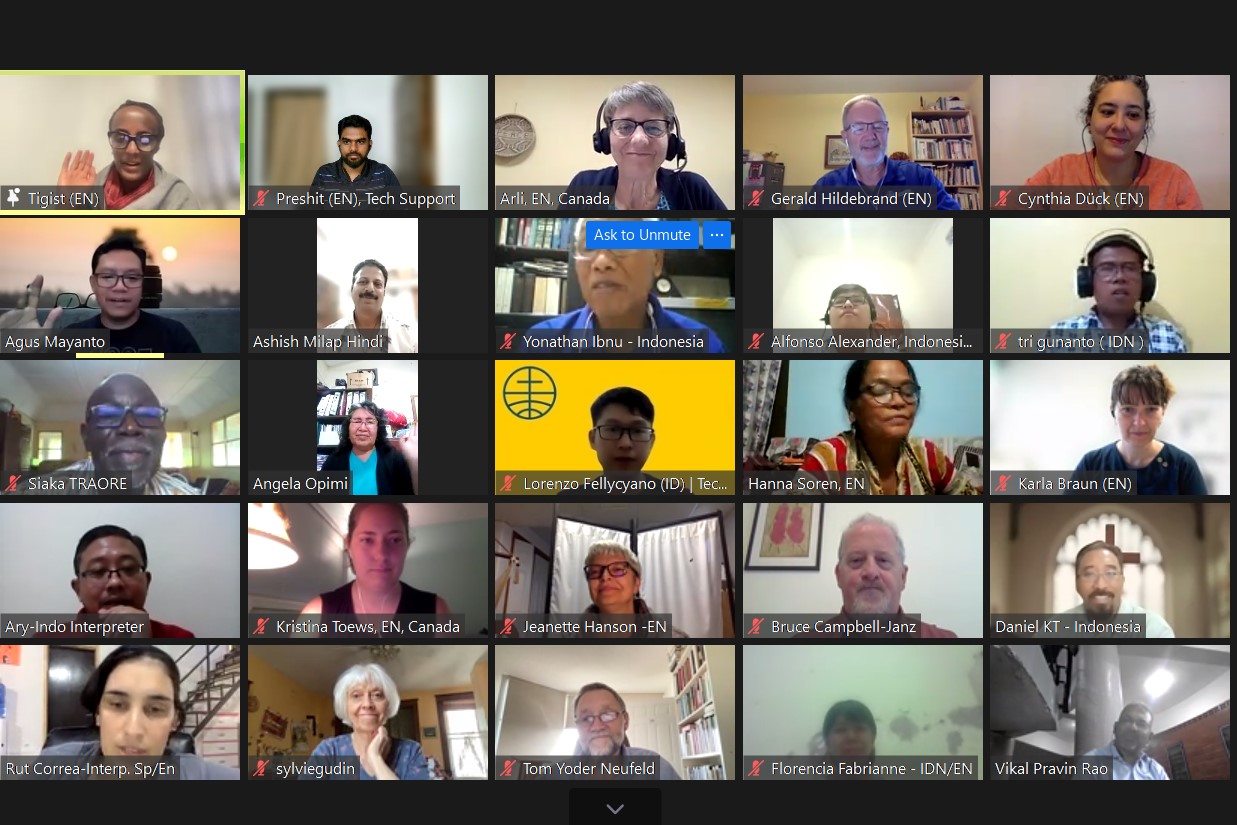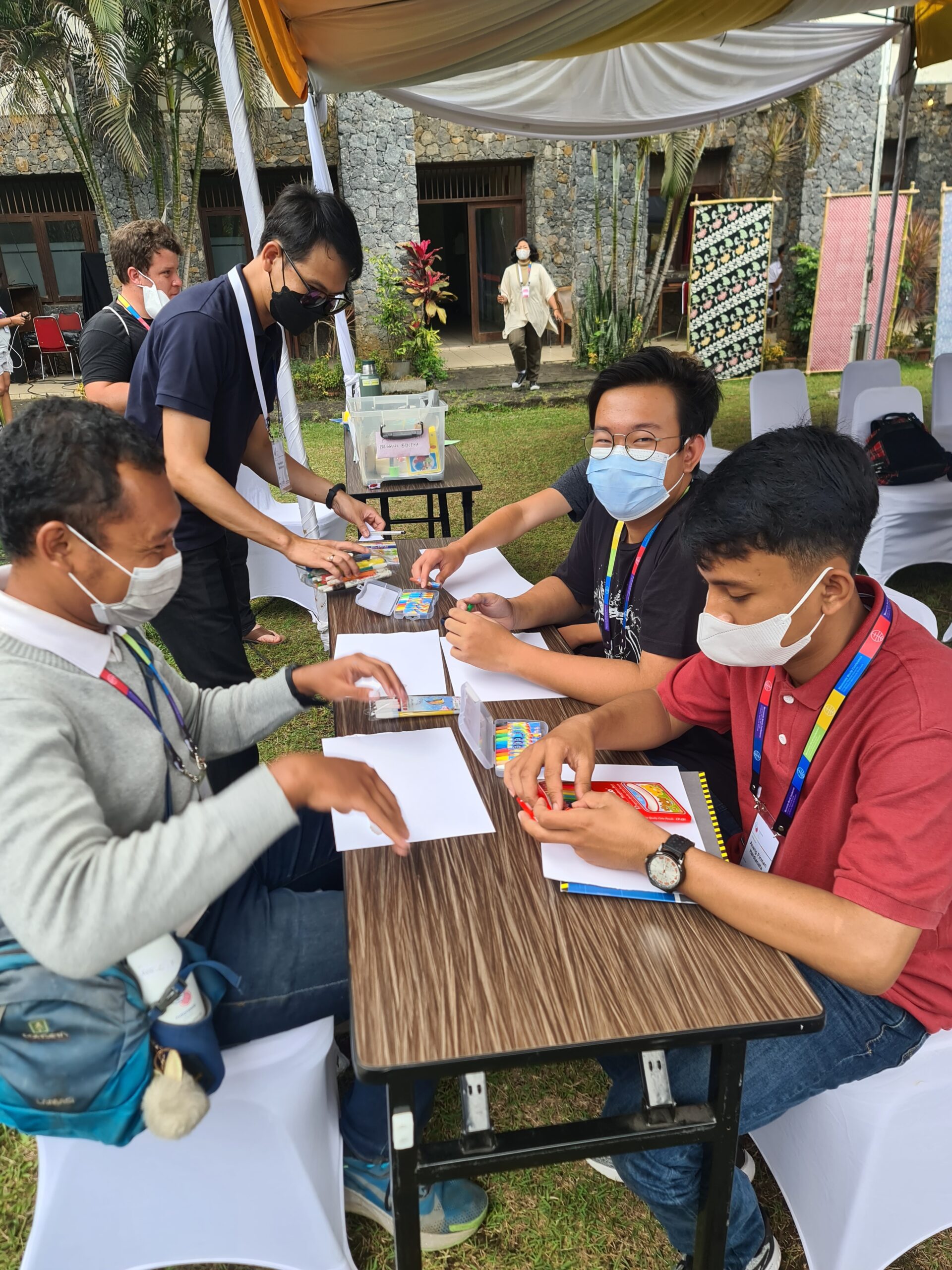Jeudi soir
En avril, j’ai reçu une invitation pour parler sur le thème ‘Vivre ensemble en milieu hostile’.
Le titre m’a vraiment touché. Et je pense que l’une des raisons pour laquelle j’ai été invité c’est que ces dernières années, nous, les Hongkongais, nous vivons dans un environnement hostile, qui ne nous est pas favorable.
Le passage de ‘Écriture qui a attiré mon attention est 2 Corinthiens 4/1.
« Aussi puisque, par miséricorde, nous détenons ce ministère, nous ne perdons pas courage. » (TOB).
J’ai aujourd’hui une soixantaine d’années, et j’ai grandi dans un environnement très favorable. Avant tous ces changements, quand on me demandait comment était Hong Kong, je répondais que la ville était vraiment agréable. Quand on vivait à Hong Kong, on se sentait en sécurité, on pouvait marcher dans la rue même à minuit, on appréciait la liberté d’expression, le système éducatif réputé, les hôpitaux bons et abordables, les emplois nombreux si on était prêt à travailler. Et surtout, tout marchait bien à Hong Kong.
Cependant, cela a changé. Le Hong Kong dans lequel je vis maintenant n’est plus le Hong Kong que je connaissais. Certaines personnes diront que les changements ont commencé en 2014. Pour moi, c’est en 2019 qu’ils ont commencé.
Le 4 juin 2019, plus de 180 000 personnes se sont rassemblées au parc Victoria de Hong Kong pour commémorer les 30 ans de la répression de la place Tiananmen.
Le 9 juin 2019, plus de 1 000 000 de personnes sont descendues dans la rue en entonnant des hymnes et elles se sont mises en grève.
C’était essentiellement une manifestation pacifique. Cependant, le lendemain, des affrontements ont eu lieu entre la police et les manifestants contre le projet de loi sur l’extradition.
Le 12 juin 2019, Hong Kong a fait face à de nouvelles manifestations contre la modification de la loi sur l’extradition. Cette fois, de nombreux responsables d’églises sont sortis dans la rue et ont parlé au gouvernement. Des frères et sœurs ont prié et chanté des hymnes sur place. Les chrétiens se soucient de la paix et de la nonviolence. De nombreuses personnes ont suivi les chrétiens pour chanter le refrain : ‘Chantez Alléluia au Seigneur’ dans les rues. Cette fois, plus de 2 000 000 de personnes sont venues protester en faveur leur liberté.
Depuis lors, les protestations et les manifestations n’ont jamais cessé. Au fil du temps, la police et les manifestants sont devenus de plus en plus violents. Je n’avais jamais vu cela depuis 1968.
Le slogan des manifestants est passé de :« Habitants de Hong Kong : Add oil »( ‘ajoutez de l’huile’ c’est un des slogans principaux, une expression d’encouragement en Cantonais)« Habitants de Hong Kong : Protestez ! » à « Habitants de Hong Kong : Vengeance ! »
Pendant un temps, il y a eu des protestations presque tous les jours. Fin 2019, plus de 7 000 personnes avaient déjà été arrêtées par la police.
« De quel côté devons-nous être ? » Les personnes extérieures aux églises veulent connaître la position des chrétiens. Les membres des églises demandent à leurs responsables de quel côté sont leurs propres églises.
En fait, les habitants de Hong Kong sont divisés entre le bleu et le jaune. Les Bleus sont ceux qui sont pour le gouvernement et la police. Les Jaunes sont ceux qui sont contre eux.
Il y a des conflits dans cette société, dans les familles et dans les églises. Il n’y a PAS DE PAIX. Notre défi est de savoir comment être pacifistes quand d’autres choisissent d’être violents ? Et comment vivre ensemble dans un environnement hostile ?
Quelles sont les positions des églises ?
Je n’oublierai jamais ceci : le 12 juin 2019, j’étais au milieu de la route le long du siège du gouvernement de Hong Kong. Ê ma droite, il y avait des chrétiens qui chantaient des hymnes et priaient pour Hong Kong, tandis qu’à ma gauche, il y avait des manifestants qui s’efforçaient de bloquer la route principale !
Ê Hong Kong, certaines églises choisissent le côté jaune, et d’autres le bleu. Cependant, nous mennonites, en tant qu’Église de paix, nous choisissons d’être du côté de Jésus. Nous voulons être un pont entre le Jaune et le Bleu, un pont entre le pacifique et le violent, un pont entre le peuple et le gouvernement, un pont entre les manifestants et la police. Nous avons l’obligation de promouvoir la paix. Nous considérons que c’est une manière de suivre Jésus « C’est notre positon ! »
En ce moment, les gens quittent Hong Kong. Dans notre église, l’église mennonite Agapé, 10% de nos membres sont déjà partis, principalement immigrés en Angleterre. Et de nombreuses personnes envisagent toujours de quitter Hong Kong pour chercher un lieu de liberté, un lieu d’espoir.
Il y a plusieurs années, j’ai écrit une chanson.
Le titre est : « Fuyant la famine – 3 millions de réfugiés quittent avec douleur leur ville natale ».
Ce poème a été écrit en 1933. Il décrit la situation et le sentiment des réfugiés qui se sont déplacés vers le nord-est de la Chine depuis leur terre natale parce qu’ils n’avaient plus rien à manger.
Cependant, à cette époque, le nordest de la Chine était sous le contrôle de l’armée japonaise. Ê mon avis, ils fuyaient un lieu de désespoir vers un (autre) lieu de désespoir. Cela m’a touché, et j’ai donc écrit un chant de 13 minutes.
Ces personnes ne savaient pas quel serait leur sort. Ils ne savaient pas ce qui leur arriverait après leur départ vers le nordest. La seule chose qu’ils savaient, c’est que s’ils ne partaient pas, ils mourraient.
Beaucoup de gens décrivent les immigrants de Hong Kong comme des réfugiés. Mais si vous immigrez, vous faites d’abord des plans. Si vous n’avez aucun projet ou si ce n’est pas votre plan d’immigrer, alors vous êtes un réfugié.
Pourquoi quittent-ils Hong Kong ? Ils ont peur du lendemain. Ils ont perdu courage pour rester à Hong Kong.
Dans 2 Corinthiens 4/1, l’apôtre Paul encourage l’Église :
« Aussi puisque, par miséricorde, nous détenons ce ministère, nous ne perdons pas courage. »
Paul les encourage à ne pas perdre espoir. Pourquoi ? Paul dit que c’est parce que « nous détenons ce ministère ».
Frères et sœurs, je vous dis aujourd’hui que je ne vais pas quitter Hong Kong.
Nous, les pasteurs, courons un grand risque. C’est nous qui devrions partir. Mais je ne partirai pas, parce que je suis appelé à rester et à fortifier les paroisses mennonites de Hong Kong jusqu’à ce que j’aie terminé ma tâche, et jusqu’à ce que je reçoive un nouvel appel de mon patron, mon Père céleste.
Frères et sœurs, si vous vivez dans les ténèbres, si l’avenir vous paraît imprévisible, si vous êtes déçus par les gens, regardez simplement vers Dieu et souvenez-vous de votre appel.
Finalement, je voudrais attirer votre attention sur la prière de l’apôtre Paul dans Éphésiens 1/17-19.
Paul demande à Dieu d’ouvrir les yeux des Éphésiens afin qu’ils voient trois choses :
- l’espérance de sa vocation,
- la richesse de la gloire de son héritage que sont les saints,
- l’immense grandeur de sa puissance.
Que notre Père céleste ouvre les yeux des chrétiens de Hong Kong.
Que Jésus nous ouvre les yeux à vous et moi.
Que le Saint-Esprit nous bénisse tous.
Parce que :
« A celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer, à lui la gloire dans l’Église et en Jésus Christ, pour toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen. » (Éphésiens 3/20-21).
—Jeremiah Choi est compositeur et pasteur. Il est actuellement pasteur de la paroisse mennonite Agapé de Hong Kong et le représentant régional de la Conférence Mennonite Mondiale pour l’Asie du Nord-Est.