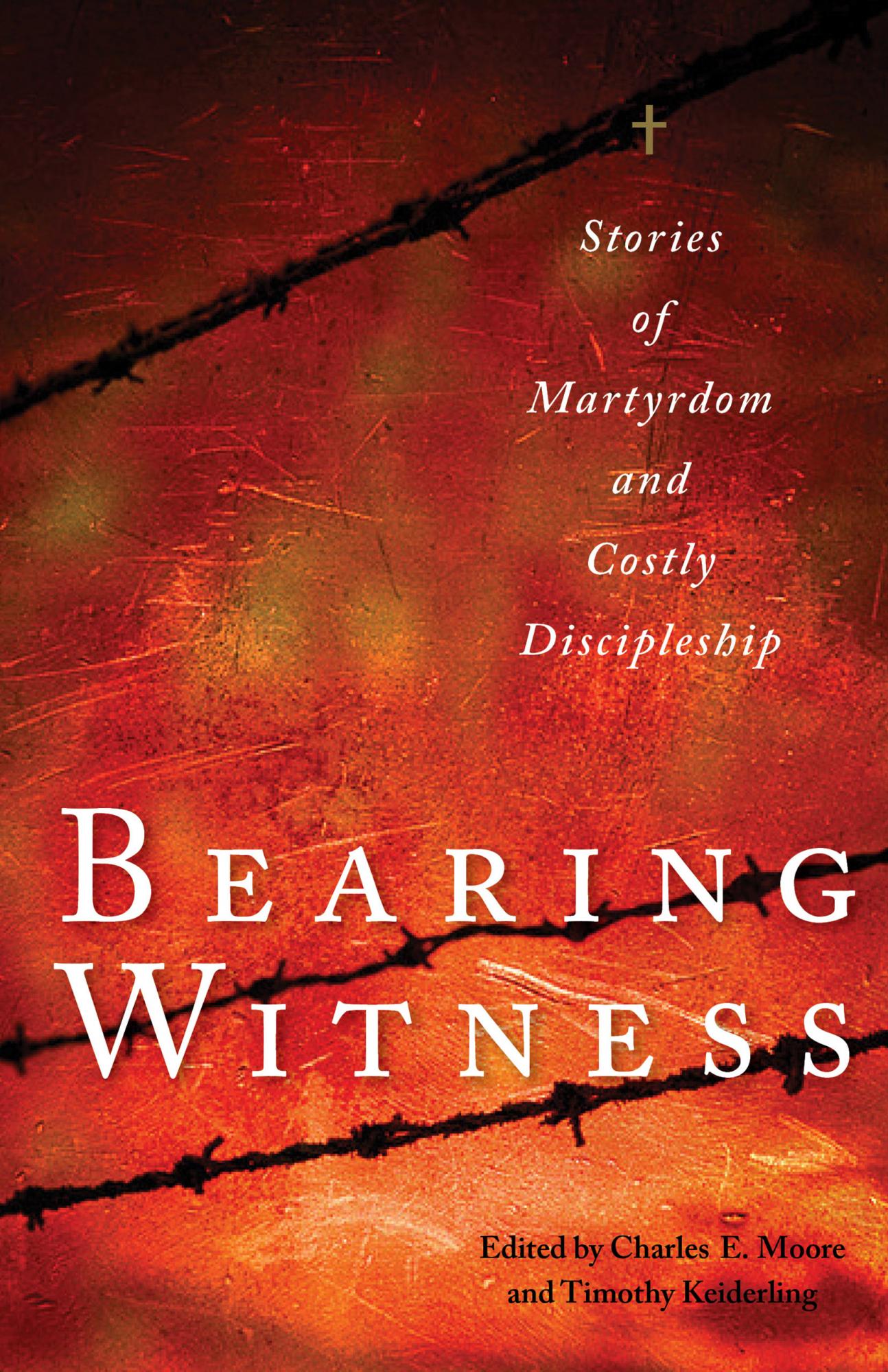Les responsables des églises mennonites nationales en Europe ont tenu leur rassemblement annuel du 28 au 30 octobre 2016 à Vienne en Autriche. La Conférence Mennonite Mondiale était représentée par Liesa Unger, responsable des événements, Henk Stenvers, représentant régional pour l’Europe, Jantine Huisman, membre du comité YABS et deux membres du comité exécutif, Rainer Burkart et Jean Paul Peterschmidt.
Prions pour les besoins des églises participantes (voir la liste ci-dessous) :
- Le renforcement de notre identité mennonite.
- Les responsables mennonites et les responsables de jeunes mennonites qui travaillent à mi-temps en allemand.
-
Pour l’unité de l’église durant ces temps de changements dans notre conférence.
-
La consolidation des petites églises.
-
Un ministère complet auprès des réfugiés.
-
L’intégration de nouveaux convertis d’origine musulmane.
-
Faire des disciples.
-
Les petites églises en particulier craignent pour leur futur. Cette peur entraine une démotivation.
-
Solidification les églises.
-
Prions que nous ne nous satisfassions pas du status quo mais que nous ayons envie de croître.
-
Que le discipulat se solidifie et que les nouveaux responsables soient plus engagés dans la mission vers l’intérieur et vers l’extérieur.
-
Nous sommes très ouverts à recevoir des missionnaires en Lituanie.
-
Que nous soyons encouragés et inspirés à être des chrétiens à chaque instant et partout où nous sommes.
-
Il y a une crise financière grave dans notre conférence qui pourrait en affecter le futur.
-
La croissance du nombre d’églises et de membres.
-
Reconnaissance pour la solidarité grandissante parmi les églises, en particulier dans l’aide aux réfugiés en Suisse et à l’étranger.
-
Recherche d’un coordinateur des jeunes pour la partie francophone de la conférence.
-
L’unité dans la diversité : cheminer vers une vision commune de la mission.
-
Convergences : une nouvelle église est sur le point de voir le jour à Genève, fruit d’un effort conjugué de la conférence mennonite suisse et de l’église de Saint Genis en France.