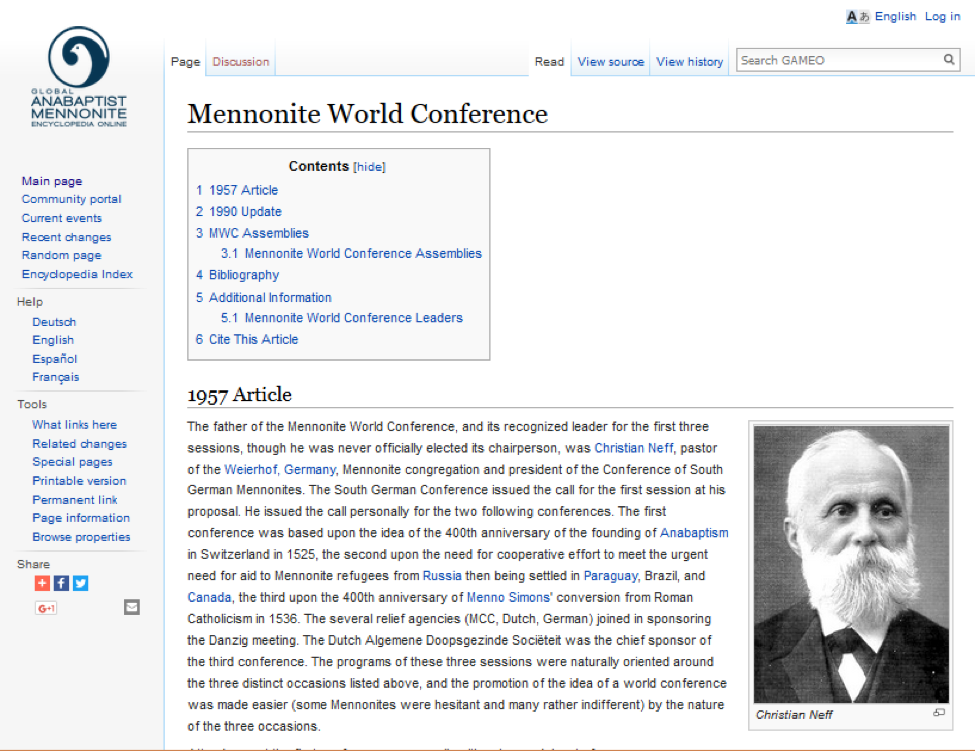Une Église de paix renouvelée demande un engagement renouvelé l’un envers l’autre ; même envers ceux et celles qui peuvent être nos ennemis. Construire des ponts résout la déconnexion. Sans relation et connexion, la paix ne peut pas s’épanouir. C’est essentiel si nous voulons nous rapprocher des personnes qui ont une foi ou une culture différente.
Un défi important dans les relations multiconfessionnelles et interculturelles est la perception de l’autre que nous créons sur la base d’hypothèses et de préjugés. Cela nous empêche de voir et de valoriser l’autre comme un enfant de Dieu. Pour surmonter ce défi, il est important de se rencontrer.
L’hospitalité joue un rôle déterminant dans le développement d’une compréhension mutuelle entre diverses opinions religieuses et culturelles. Les Églises ont la responsabilité de créer des espaces où un engagement authentique peut se produire. Cependant, les Églises doivent également incarner la spiritualité d’un étranger, d’un invité, et assumer une position de vulnérabilité. Cela crée une disposition à tendre la main. L’église n’a plus à attendre pour accueillir les autres, mais peut entreprendre de nouvelles formes de relations avec les autres.
L’Église mennonite javanaise à Jepara le fait en visitant ses voisins musulmans. Les mennonites de Jepara représentent environ 1% de la population totale, essentiellement musulmane. Il n’y a pas d’animosité entre les différentes religions à Jepara, mais même si notre Église se trouve à seulement 300 mètres du bâtiment d’une organisation islamique, il n’y a pas eu beaucoup de relations entre les chrétiens et les musulmans !
Lorsque notre Église a décidé de prendre au sérieux l’appel à être une Église de paix, nous avons priorisé l’établissement de relations avec les personnes d’autres religions dans notre ville. La première étape fut de visiter un des jeunes leaders islamiques et de faire connaître notre rêve d’établir des relations entre les mennonites et les musulmans à Jepara. Ensemble, nous avons organisé une performance artistique et culturelle lors de laquelle nos communautés, et pas seulement nos dirigeants, pouvaient participer et apprendre à se connaître. Nous avons également mis sur pied des rencontres pour diminuer les perceptions erronées sur l’autre.
Cela a nécessité un long processus. C’était difficile de regarder au-delà de notre suspicion (ou des idées préconçues) à l’égard de l’autre. Après sept ans, nous entretenons de bonnes relations avec nos voisins musulmans. Nous célébrons ensemble la Journée internationale de la paix ; l’Église participe à leurs célébrations d’anniversaire ; ils participent à nos célébrations de Noël, même si une fatwa interdit les musulmans de donner des salutations de Noël aux chrétiens en Indonésie.
Prendre la position d’un visiteur demande de l’humilité. Nous abordons les autres sans avoir une image exacte de ce qu’ils sont. Cela nous oblige à aborder quelqu’un avec respect et confiance, et croire que nous avons quelque chose à apprendre de ceux et celles qui peuvent être différents. La vulnérabilité inhérente au statut de visiteur ou d’étranger fait que l’on a besoin de l’autre. Cela signifie que nous n’allons pas vers l’autre avec arrogance et pouvoir, mais avec ouverture et sincérité, étant vulnérables avec la possibilité d’être rejetés.
Une telle approche, cependant, suscite l’espoir. En étant un invité vulnérable, nous accueillons la prière et la bénédiction de l’autre, même si l’autre est notre ennemi. C’est la posture que Jésus affiche par son incarnation. La réconciliation que Jésus offre entre l’humanité et Dieu est rendue possible grâce à son exemple comme invité dans le monde. Il s’est dépouillé et a pris la condition de serviteur, montrant ainsi l’humilité. Il a accepté la souffrance, ce qui a montré sa vulnérabilité (Philippiens 2/6-8). Sa posture a donné les moyens de réaliser la paix de Dieu (Éphésiens 2/14) qui nous donne l’espoir et le courage.
— Danang Kristiawan (Indonésie), Communiqué de la Conférence Mennonite Mondiale
Ce témoignage fait parti du materiel pour le culte du Dimanche de la Paix de 2017. Pour en savoir plus, cliquez ici : www.mwc-cmm.org/dimanchedelapaix