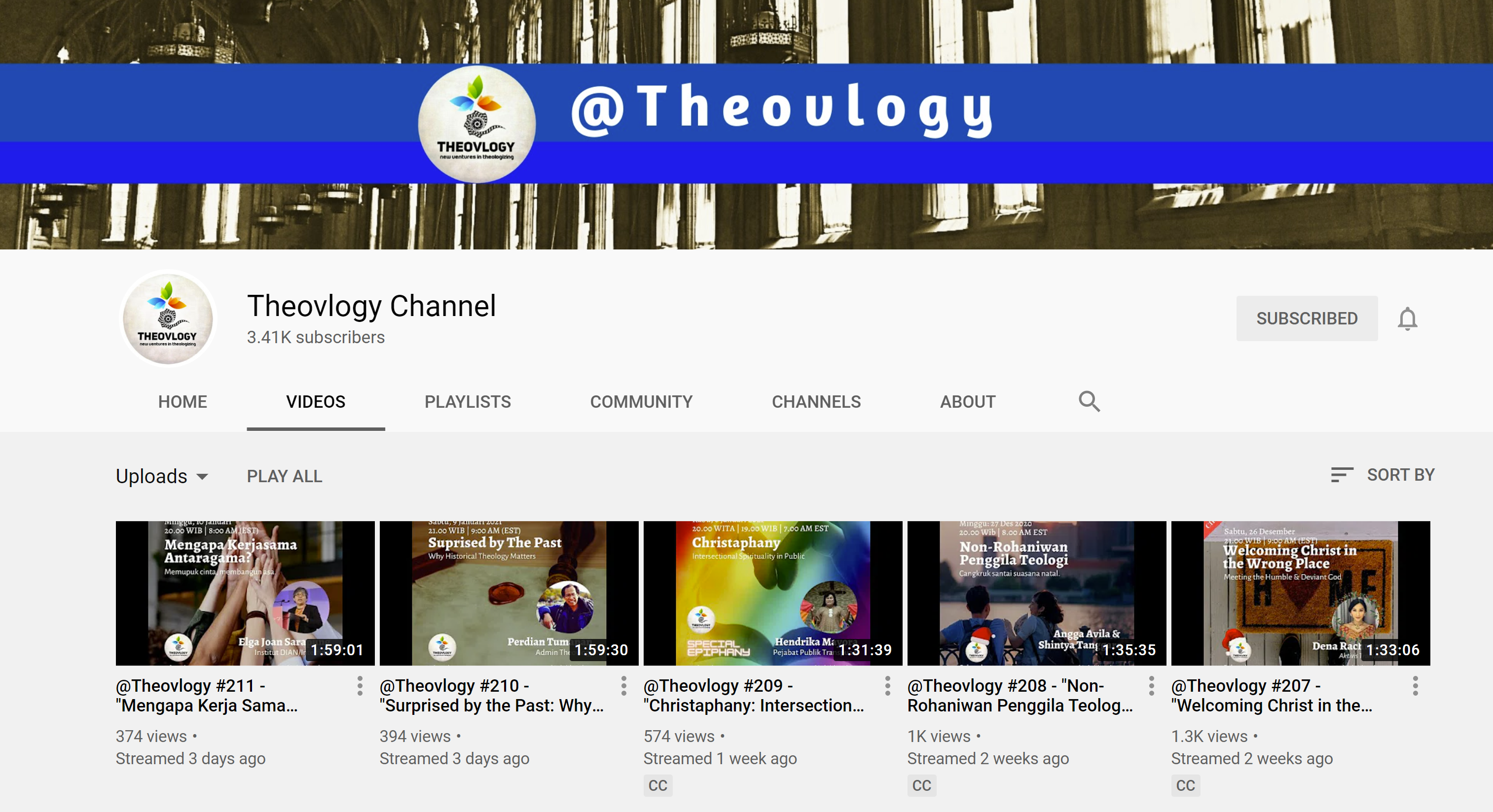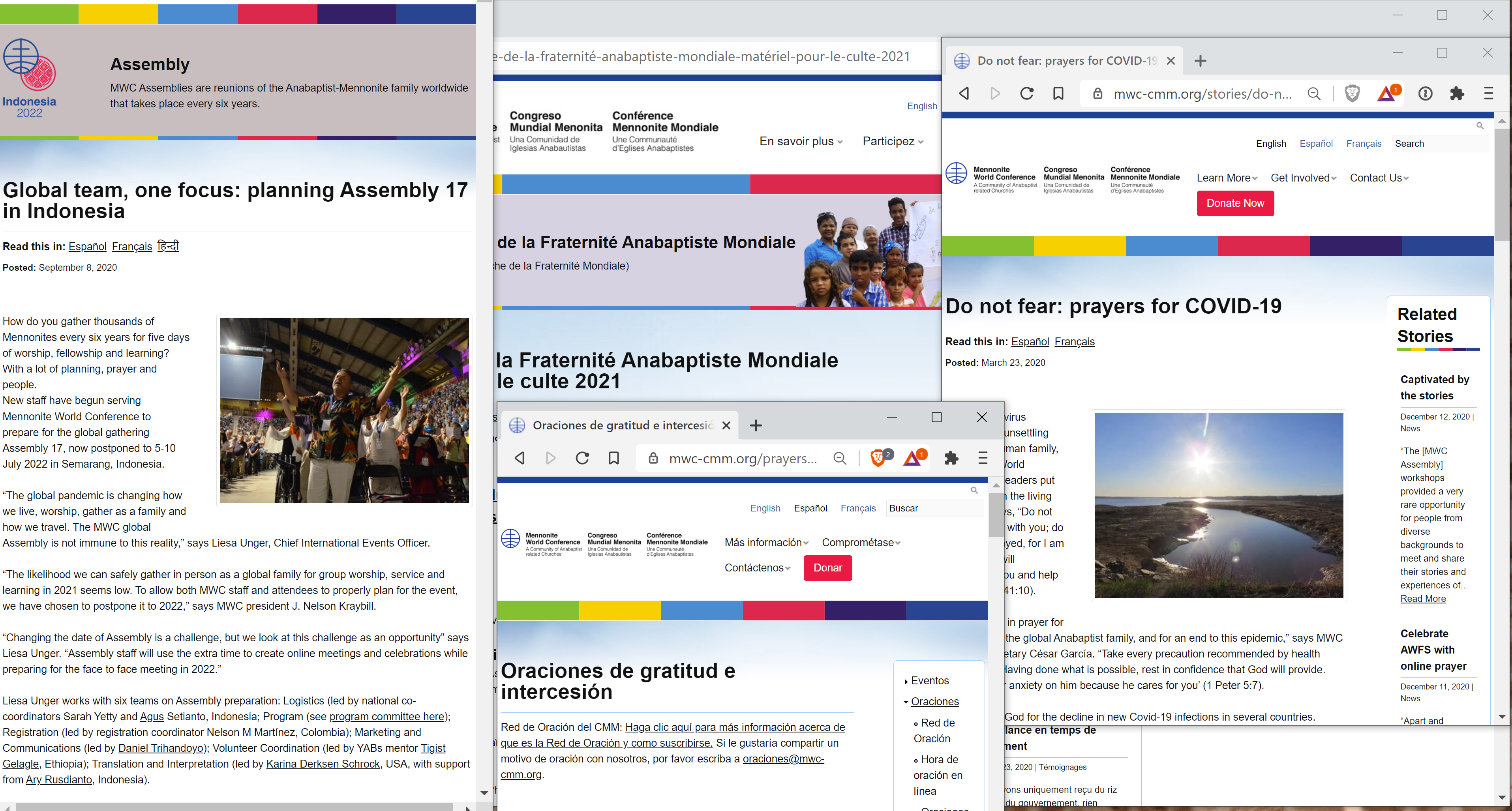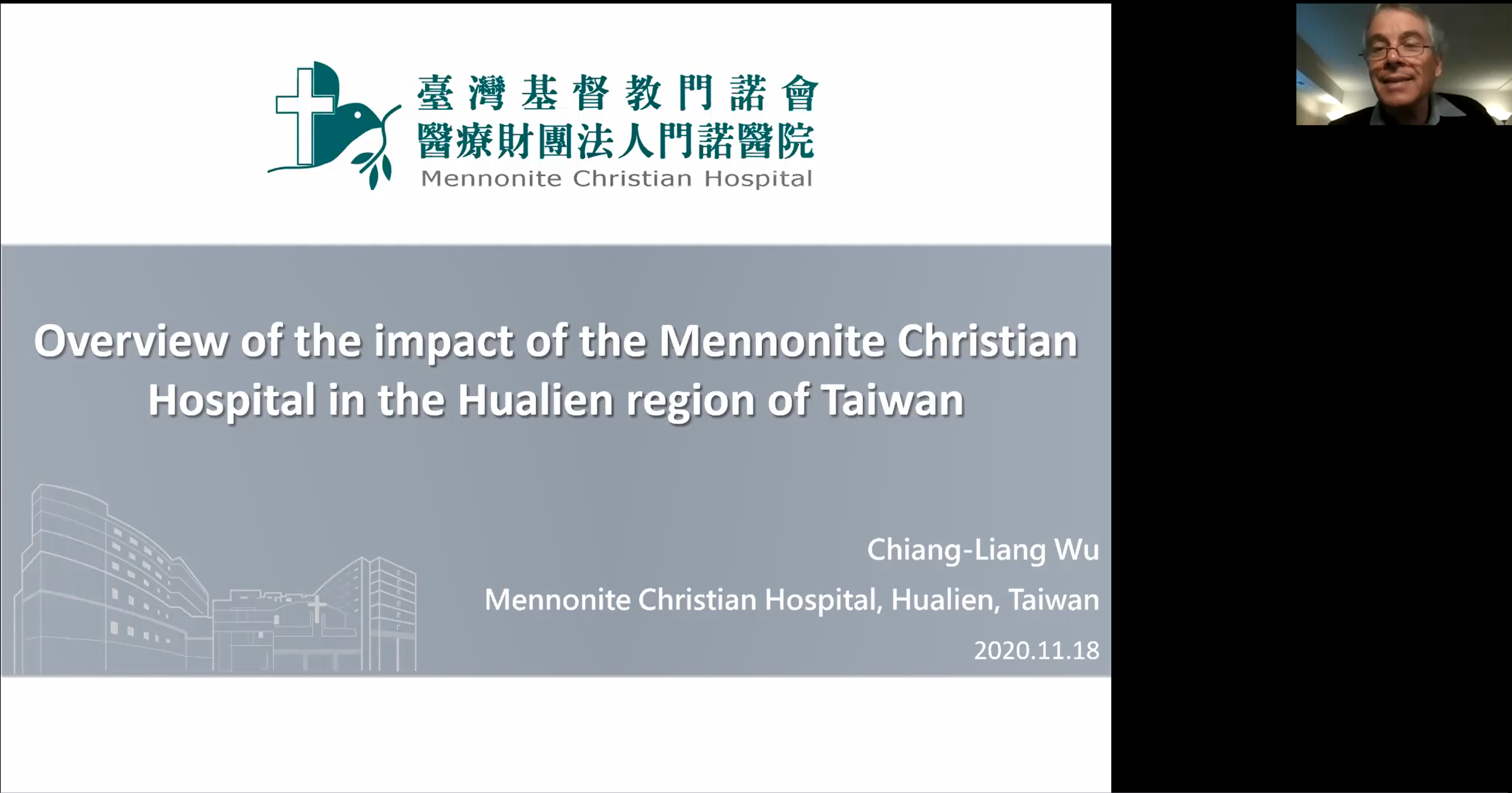Nindyo Sasongko pense que la théologie devrait être accessible à un public plus large. Il a commencé une expérience de discussions en ligne en novembre 2018 ; lorsque la pandémie a frappé, ‘Theovlogy’ s’est développé pour répondre à la demande de connexion en ligne.
« Ê l’origine, ‘Theovlogy’ était destiné aux laïcs indonésiens sans formation théologique. Nous avons commencé par des sessions de 15 à 20 minutes sur des questions de théologie accessibles à un large public. Plus tard, nous avons découvert que notre audience avait augmenté – non seulement en Indonésie mais aussi du fait de la présence de mes collègues.
Le professeur de théologie et candidat au doctorat a invité ses collègues étudiants en théologie – d’Indonésie, mais aussi du monde entier, de l’Australie aux États-Unis – à se joindre à lui dans d’humbles conversations en ligne. Trois des six fondateurs sont des mennonites : Nindyo Sasangko, et un deuxième étudiant en théologie, Adi Widya Nugroho, ont été élevés dans l’église GKMI en Indonésie. Perdian Tumanan étudie à AMBS, Elkhart-Indiana (États-Unis). Ces rencontres sont devenues ‘Theovlogy’, un canal de discussion théologique en ligne avec près de 2 500 participants.
Soucieux de l’accessibilité à Internet pour tous, Nindyo Sasongko convertit les enregistrements en audio pour les podcasts. Mais il voit les barrières d’accès fondre. Pendant la pandémie, les habitants des régions rurales d’Indonésie ont parfois une meilleure connexion que lui à New York City, États-Unis.
‘Theovlogy’ a été lancé en anglais (et à un public plus large) lors du Festival mondial anabaptiste pour la paix, organisé par la Conférence Mennonite Mondiale aux Pays-Bas en 2019, lors d’un entretien avec l’historien mennonite Ben Goossen.
Les traditions religieuses du public sont différentes : « Ce sont probablement des chrétiens plus progressistes, mais il y a aussi des conservateurs. »
Les participants ont inclus des experts bien connus dans leur domaine, mais ils ont commencé par inviter leurs amis.
« Nous voulions fournir une forme non élitiste. Nous avons invité des étudiants passionnés de théologie et ayant rédigé un article publié. »
Un nouvel intérêt pour la conversation théologique
La pandémie a été « une bénédiction déguisée » pour ‘Theovlogy,’ dit Nindyo Sasongko. Les organisateurs étaient pris par leurs travaux universitaires ; six mois se sont écoulés sans nouvel session. Puis la fermeture a eu lieu à la mi-mars et tout le monde a eu du temps à la maison. « Je pensais que je serais fou si je me préparais juste pour les cours. » Ainsi, ‘Theovlogy’ a ressuscité. Plus tard, Nindyo Sasongko a découvert d’autres podcasts en Indonésie qui suivaient ce modèle.
L’enseignement des cours en ligne a épuisé Nindyo Sasongko. « Avant la pandémie, [pour discuter de questions théologiques], nous rencontrions nos auditeurs et ils nous posaient des questions directement. Maintenant, nous n’avons accès qu’à leurs écrits, nous ne pouvons répondre qu’à de courtes questions et nous ne pouvons pas voir leur expression.
« Mais avec ‘Theovlogy,’ nos conversations m’ont rendu mon énergie ! »
« Nous avons constaté que les gens peuvent suivre et interagir tout en écoutant nos conversations », explique Nindyo Sasongko. « Avant la pandémie, l’attention des auditeurs durait de 20 à 25 minutes. Mais maintenant, ils restent environ une heure – même si les sujets théologiques sont difficiles. Ils s’intéressent à ce dont nous parlons. Ils peuvent revoir ou réécouter les sessions. Je n’avais pas vu cela se produire avant la pandémie. »
« Grâce à ce podcast, nous avons découvert que nous avions créé une communauté ». Les hôtes et les invités interagissent avec le public pendant la session de questions et réponses en direct, et par le biais de commentaires sur les sessions enregistrées. Il y a dans le public des personnes qu’aucun des organisateurs n’a jamais rencontrées. « Même au-delà des traditions religieuses. »
« C’est un espace sûr », dit-il. « Les hôtes et les invités parlent de foi et de religion sans être jugés sur la doctrine, le dogme ou les règles. »
« Nos auditeurs peuvent avoir accès à des sujets théologiques auxquels ils ne s’attendaient pas. Beaucoup d’entre eux pensaient qu’il s’agirait de défense de la foi, ou d’apologétique. Mais les podcasts présentent différentes perspectives théologiques. Les auditeurs découvrent que la théologie peut être abordée non d’un point de vue apologétique, mais collégial, conversationnel et tolérant. »
‘Theovlogy’ a invité un universitaire musulman et un agnostique. « Nous ne connaissions pas ce genre de christianisme présentant une telle ouverture et hospitalité », leur ont dit les invités tout comme les auditeurs.
« En un sens, il me semble que c’est une approche mennonite qui va vers la réconciliation », dit Nindyo.
Des cours pour une nouvelle normalité ?
« Lorsque nous le pouvons, nous nous asseyons ensemble et nous parlons », dit Nindyo.
Mais, entre-temps, il constate le potentiel de cette expérience, même à distance et sur écran, pour créer un lien : un sentiment de communauté qui est essentiel dans la conception de l’Église des anabaptistes.
« L’Église fait tomber les barrières. C’est ce qu’on fait, d’une nouvelle manière – les services en ligne – permettant aux gens du monde entier de participer ensemble à l’Église. C’est peut-être ce que veut dire l’apôtre Paul quand il écrit qu’en Christ, toutes les frontières sont abolies, qu’il n’y a ni juif ni grec. »
Les discussions en ligne permettent aux personnes de différentes traditions religieuses de dialoguer et d’apprendre. « Ê Manhattan Mennonite Fellowship, nous avons invité un soufi à nous parler. Cela a permis à ses disciples de suivre depuis l’Indonésie. » Une fois, un rabbin juif a invité ses collègues à regarder.
« Je pense que cela pourrait être l’avenir de l’Église. »
« Il y a une ouverture qui n’existe pas lorsqu’on se retrouve entre quatre murs », dit-il.
« Ma propre théologie est remise en question lors des réunions en ligne. Je suis vulnérable ; Je dois être prêt à m’émouvoir, à être interpellé, interrompu, changé et transformé par mes rencontres avec les autres. Je découvre que je suis encore en devenir, et ce processus est parfois douloureux. »
« Alors que tout le monde est connecté via Internet aujourd’hui, je réfléchis à ce que signifie qu’être humain. C’est être ouvert à la vulnérabilité, car ce n’est qu’ainsi que nous apprenons à découvrir de nouvelles possibilités. »
— Nindyo Sasangko est professeur de théologie et candidat au doctorat au Fordham University, New York, États-Unis. Il est pasteur de l’église Mennonite de l’Indonésie GKMI (Gereja Kristen Muria Indonesia). Il est aussi membre de le Groupe de travail de la CMM pour la protection de la création.
Nindyo Sasangko est professeur de théologie et candidat au doctorat au Fordham University, New York, États-Unis. Il est pasteur de l’église Mennonite de l’Indonésie GKMI (Gereja Kristen Muria Indonesia). Il est aussi membre de le Groupe de travail de la CMM pour la protection de la création.
Cet article est paru pour la première fois dans le numéro d’octobre 2019 de Courier/Correo/Courrier.





 Nindyo Sasangko est professeur de théologie et candidat au doctorat au Fordham University, New York, États-Unis. Il est pasteur de l’église Mennonite de l’Indonésie GKMI (Gereja Kristen Muria Indonesia). Il est aussi membre de le
Nindyo Sasangko est professeur de théologie et candidat au doctorat au Fordham University, New York, États-Unis. Il est pasteur de l’église Mennonite de l’Indonésie GKMI (Gereja Kristen Muria Indonesia). Il est aussi membre de le