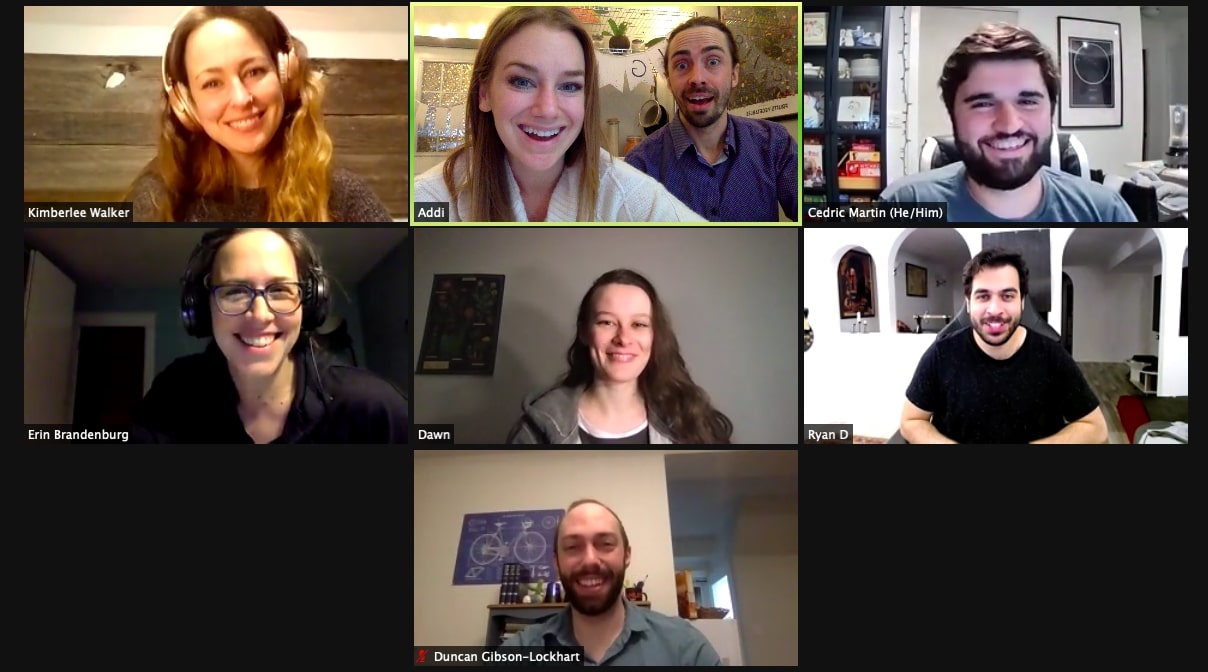« Au cours des 100 dernières années, le monde a énormément changé et en même temps, pas tant que cela », dit Henk Stenvers. L’Église et la société font face au nationalisme et à la polarisation, et même à la guerre en Ukraine.
« Alors que nous nous préparons à marquer les 100 ans de la CMM et les 500 ans de l’anabaptisme en 2025, il est temps de regarder vers l’avenir », déclare Henk Stenvers. « C’est le moment d’examiner la signification de notre message et de notre mission pour les années à venir. Les questions importantes au temps de la Réforme le sont-elles toujours pour nous ? Avons-nous de nouvelles questions ? certaines n’ont-elles plus de sens ? »
« L’étude de l’histoire des traditions de notre Église nous aide à nous rappeler qui nous sommes vraiment et à nous souvenir de notre vrai fondement qui repose sur la Bible », dit Tigist Tesfaye.
« Le renouveau ne consiste pas à retourner au passé, même s’il faut s’en souvenir », dit Tom Yoder Neufeld. « Le renouveau, c’est s’ouvrir au souffle vivant de Dieu, le Saint-Esprit (Ezéchiel 37).
« C’est la promesse, au cœur de l’appel à la repentance, à faire ‘demi-tour’ et aller dans une nouvelle direction. C’est le don du pardon, qui ouvre l’avenir à la réconciliation. C’est au centre du drame du baptême, la mort avec le Christ et la marche dans la nouveauté de vie : vivre la résurrection. Il réside dans l’espoir d’un nouveau ciel et d’une nouvelle terre », dit Tom Yoder Neufeld.
« Le renouveau implique de regarder le passé avec de nouvelles lentilles ainsi que de d’imaginer de nouveau le présent et l’avenir », dit Andrés Pacheco Lozano. « Pour être renouvelés, nous devons redire notre histoire particulière. Redire notre histoire peut être une expérience transformatrice car cela nous permet de (re)façonner les narratifs qui forment notre identité. Cette créativité libératrice ouvre la possibilité à de nouvelles interprétations pour vivre la radicalité du message évangélique de justice et de paix dans le présent et dans l’avenir ».
« Le renouvellement nous fait passer de l’ancien au nouveau », dit Andi Santoso.
« Le Dieu qui est aussi esprit appelle les gens à différentes époques de l’histoire, toujours pour apporter quelque chose de nouveau et nous connecter à Dieu. La nouveauté est quelque chose de spirituel et de naturel (par exemple, il y a des saisons – le printemps après l’hiver) », explique Andi Santoso.
« Il est important d’être dans un état constant de renouvellement », dit Lisa Carr-Pries. « Cela n’arrive pas une fois pour toutes. Nous devons toujours être à l’écoute : le renouveau a besoin de nos oreilles et nécessite aussi un changement constant de perspective. »
« Le vin nouveau ne peut pas être mis dans de vieilles outres, il éclatera », dit Sunoko Lin, réfléchissant à Marc 2. Lorsque Jésus a dit à l’homme paralysé de prendre sa natte et de rentrer chez lui, il lui a donné plus qu’il n’attendait : la capacité de marcher et de porter quelque chose. « Le renouveau apporte quelque chose de nouveau ou de meilleur. Jésus a promis du vin nouveau, des outres neuves ; non seulement pour marcher, mais aussi pour porter une natte. »
Être radical
« Le besoin de renouvellement reste constant, que nous nous focalisions sur notre identité (qu’est-ce que signifie être anabaptiste ?) ou sur notre mission (quelle est notre mission dans le monde ? Est-ce l’évangélisation ? le rétablissement de la paix ?) », dit Tom Yoder Neufeld.
« Je ne pense pas que le renouveau consiste à adapter l’anabaptisme à différents contextes et réalités, mais plutôt à voir les nuances des nouvelles formes ou visions de l’anabaptisme qui ont émergé dans des endroits différents », dit Andres Pacheco Lozano. « La manière dont la tradition anabaptiste s’est développée à un endroit donné et la façon dont les individus, les paroisses et les communautés de ces endroits l’ont mise en pratique en font des compositions hybride uniques dans de nombreuses régions du monde. »
Il dit qu’il faut parler non seulement de polygenèse mais aussi de polyanabaptisme pour discerner des différences et des variations. « Un espace comme la CMM a le potentiel de les faire dialoguer, ce qui est l’un des dons les plus importants de la conversation anabaptiste de notre communion mondiale. »
Un jeune pasteur des Pays-Bas a dit à Henk Stenvers : « Nous redeviendrons vraiment mennonites lorsque la police frappera à nos portes. Le message de paix du Christ était radical. Est-ce que nous, dans le Nord, sommes trop bien intégrés dans la société par notre conformisme aux autorités et aux systèmes économiques ? »
« Y a-t-il un renouveau dans notre relation avec les autres ? » demande Andi Santoso. Nous devons remettre en question le statu quo et considérer aussi l’aspect social du salut. « En lui, Jésus a apporté la réconciliation : faisons-nous une différence dans le monde en œuvrant pour la paix et la justice ? Y a-t-il un changement dans la manière dont nous nous comportons ? »
« Aujourd’hui, le renouveau devrait nous mettre mal à l’aise… surtout si nous détenons pas mal de pouvoir » déclare Anicka Fast. « Lorsque le mouvement anabaptiste a commencé, il était perturbateur et gênant. Les gens en marge de l’Église ont contesté ce que disaient ses puissants dirigeants. Le renouveau sera souvent déstabilisant. »
Historienne, elle étudie l’histoire des églises en Afrique : elle est animée par des vagues de réveil, dirigées par des Africains, dirigées par des femmes.
Le Réveil est-africain a commencé dans les années 1930 et a balayé le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. « Tout a commencé par des amitiés et une communion fraternelle entre chrétiens africains et missionnaires européens et nord-américains. Ils se repentaient ensemble de leurs comportements les uns envers les autres. Ils ont développé de solides amitiés et sont devenus des groupes très unis appelés fraternités de réveil. »
« Le premier évêque mennonite de Tanzanie, Zedekiah Kisare, a rappelé que lorsque le réveil est arrivé chez lui, c’était comme si une mèche avait allumé de la dynamite : c’était une explosion ! », raconte Anicka Fast. « Tous ont commencé à pleurer. Ils ont changé de vie. L’évêque missionnaire américain a changé son attitude de supériorité envers les chrétiens africains. C’était un revirement complet qui a conduit à une nouvelle façon de vivre ensemble. »
« Le réveil a fait exploser les frontières entre les dénominations. Les gens voulaient prendre la Sainte Cène tous ensemble », dit Anicka Fast. Malheureusement, « parfois, le renouveau se produit et nous nous accrochons à ce qui est ancien et nous le bloquons ».
Prendre des risques
Parfois, nous devons tout abandonner pour vivre de nouvelles expériences et vraiment dépendre de Dieu, dit Andi Santoso. Il l’a fait personnellement, laissant derrière lui sa culture et son ministère, pour étudier aux États-Unis. « En voyant de nouvelles réalités, je remets en question ma propre foi et mes convictions. Si Dieu existe, où est l’amour de Dieu dans cette réalité brisée ? L’aspect communautaire des églises se développe alors que nous devenons des thérapeutes souffrants, des bâtisseurs de paix brisés. »
Le besoin de renouvellement ne doit pas nous mettre sur la défensive. « Nous avons encore des difficultés : difficultés interculturelles et énormes différences de situation économique. La manière par laquelle le Nord est devenu si riche : les flux économiques vont de pair avec l’exploitation des pays d’Afrique pour le bien-être du Nord ; ce sont des raisons de se repentir », déclare Henk Stenvers. « Une partie du renouveau consiste à reconna√Ætre que les choses doivent changer. »
S’appuyant sur les travaux de la théologienne Dorothee S√∂llee sur la spiritualité, Andrés Pacheco Lozano identifie le renouveau comme un processus (spirituel) qui comprend trois dimensions. Via positiva : qui célèbre les dons et la manière dont ils s’expriment à différentes époques et dans différents contextes ; Via negativa : le lâcher prise sur l’ego, la confrontation des manières dont nous avons bénéficié ou renforcé les systèmes oppressifs (y compris la discrimination fondée sur les races, les genres, les capacités ou les classes, et d’autres formes d’injustice et de violence, y compris l’urgence climatique induite par les êtres humains), l’exploration des souffrances qu’elles ont causées et les efforts pour réparer les relations rompues. Via transformativa : être soi-même transformé pour transformer les injustices et la violence dans le monde.
« Les dons sur lesquels nous construisons [nos vies], les problèmes que nous affrontons et que nous délaissons, les blessures que nous entretenons, nous invitent à être transformés et à incorporer de nouvelles pratiques, de nouvelles compréhensions, de nouvelles façons de voir l’anabaptisme », dit Andrés Pacheco Lozano.
Stratégies
« Le renouveau est individuel, mais c’est aussi un choix que l’on peut faire en tant que communion […] comme de prendre les décisions par consensus, par l’échange, même si cela prend beaucoup de temps », explique Henk Stenvers. « Ensemble, dialoguant les uns avec les autres et avec l’Esprit, nous voulons découvrir ce que Dieu nous dit. Pour cela il faut être ouverts les uns envers les autres (écouter ce que les autres disent), être ouverts par rapport au temps (ne pas être pressés de prendre des décisions) et être à l’écoute de l’Esprit. »
L’écoute est ce qui motive les gens. « Que vous dit la Bible ? Que me dit la Bible ? Comment pouvons-nous nous mettre d’accord ? »
« Si nous venons d’un endroit où il n’y a pas eu de renouveau, il peut être difficile d’être en mesure d’entendre ceux qui en ont vécu un », explique Anicka Fast. « Les témoignages peuvent sembler étranges, mais l’œuvre du Saint-Esprit est souvent surprenante. Il franchit les barrières. Le renouveau se produit lorsqu’on fait un pas, ensemble ou en tant que groupe, et qu’on commence à se repentir ensemble, à prier ensemble et à étudier la Bible ensemble en petits groupes ».
« Le renouvellement et le renouveau ont une dimension très politique. Ils ne sont jamais limités à la vie intérieure des personnes. Historiquement, les réveils commencent presque toujours par des mouvements de repentance : réparer ce qui a été brisé, ceci souvent dans les relations.
« Le renouveau est lié à la mission : agrandir la famille de Dieu » ajoute Anicka Fast. Reconna√Ætre dans nos propres cœurs là où nous ne sommes pas fidèles – et ensuite changer. Ce qui en ressort est à la fois une nouvelle façon d’être Église et de nouvelles perspectives sur les relations sociales.
Lors de la guerre anticoloniale des Mau Mau au Kenya dans les années 1950, les ‘abalokole’ (les ‘sauvés’) ne participaient pas à la guerre. Ces personnes disaient « Je ne peux pas tuer quelqu’un pour qui Christ est mort ». Ils s’appuyaient sur l’idée forte que Jésus fait de nous un nouveau type de famille – une famille au-delà des frontières des ethnies, des races et des nationalités – comme raison de ne pas soutenir l’un ou l’autre côté en guerre », dit Anicka Fast.
« La seule façon de se transformer est de le faire par la pratique », dit Lisa Carr-Pries. « Nous sommes tentés de dissimuler nos mauvais côtés parce que nous craignons d’être condamnés ou rejetés par les autres ; nous n’aimons pas les responsabilités parce que nous aurions honte de ne pas être à la hauteur. Ce n’est pas ce que l’église doit être si nous voulons vivre un renouveau. Admettons que nous avons fait une erreur et que nous voulons faire mieux.
« Nous devons essayer des faire des choses radicales qui nous mettent mal à l’aise », dit Lisa Carr-Pries. « Nous devons être une communauté qui ressemble à un trampoline : il est souple, il nous rattrape avant d’être blessés et c’est amusant. »
Il y a des étapes dans les formes de pratique. Nous n’allons pas réussir immédiatement après avoir essayé. Il est possible de faire des erreurs et il est possible de les réparer. Et nous partons du principe que tout le monde ne sera pas d’accord. » dit Lisa Carr-Pries.
« La réparation et le pardon ne sont pas nécessairement la même chose. Épanouissement, réconciliation, retour aux sources, appartenance – ce sont des mots qui invitent à la transformation dans les communautés où nous les exerçons. »
« Si nous évitons de discuter de certains sujets et si nous limitons les conversations, nous agissons de façon très contre-productive. Au contraire, les espaces mondiaux devraient précisément nous aider dans notre processus de renouveau : comprendre que les frères et sœurs dans la foi vivant dans différents contextes auront d’autres façons de contribuer à nos propres luttes et à nos propres questions sur ce que signifie être une église », dit Andrés Pacheco Lozano.
« Nous allons devoir faire des progrès pour accepter qu’il peut y avoir plusieurs vérités en même temps », déclare Lisa Carr-Pries. « Cela ne veut pas dire être tièdes ou de ne pas se prononcer. »
Aujourd’hui, l’Église fait face à de multiples difficultés, que ce soient les divisions internes jusqu’à l’urgence climatique dans le monde. La crise révèle le besoin de renouveau – et éviter de faire face à tous les défis est en soi de la violence.
Idéalement, le CMM devrait créer des espaces, des opportunités et des conditions pour que des relations se développent et aussi pour avoir des conversations difficiles et ainsi être transformés.
« L’Église est comme un système vivant. Un système qui n’a pas d’échange avec l’environnement qui l’entoure est immobilisé. Il meurt à long terme. Nous devons tirer les leçons de notre héritage sur la paix et la résolution des conflits. Nier les conflits n’est pas la solution. Mais si on les aborde convenablement, ils peuvent conduire à la transformation non seulement des opinions, mais aussi des relations, pour notre plus grand bien. »
« Il n’est pas facile d’être assis dans une pièce avec des personnes qui ont des expériences différentes ou qui interprètent théologiquement et ecclésiologiquement des expériences similaires autrement » dit Andrés Pacheco Lozano. « Mais, comme dans une famille, quand vous êtes à table, vous parlez aussi des choses difficiles. En mettant de côté certaines des dynamiques de pouvoir liées à la métaphore familiale, les repas permettent de partager à la fois des joies et des sujets difficiles, fréquemment espérons-le, et où nous pouvons aborder des questions autrement. »
« Nous devrions être encouragés, remis en question, transformés et renouvelés par la façon dont nous apprenons de nos frères et sœurs dans d’autres parties du monde. C’est ce qui est beau et malaisé en même temps. Peut-être que la diversité est ce qui nous en donne la possibilité. La CMM donne des opportunités de croissance » dit Andrés Pacheco Lozano.
« Il y a beaucoup de raisons d’espérer. La CMM est un exemple de la manière dont on peut franchir les barrières culturelles, nationales et aussi théologiques, et être toujours une seule communion », déclare Henk Stenvers. « Notre défi est d’être ouvert ; changer même si nous ne savons pas ce que ce changement apportera. Quand le Christ nous demande d’être un, la seule manière de l’être, c’est dans l’espérance et la confiance en Dieu. »
Anne Marie Stoner-Eby, ‚ÄúBuilding a Church Locally and Globally: The Ministry of Zedekiah Marwa Kisare, First African Bishop of the Tanzanian Mennonite Church,‚Äù Journal Biographique Des Chrétiens d’Afrique 7, no. 2 (July 2022): 26.
Festo Kivengere y Dorothy Smoker, Revolutionary Love (Moscow, Idaho: Community Christian Ministries, 2018).
David W. Shenk, Justice, Reconciliation and Peace in Africa, Revised edition (Nairobi: ‘Uzima Press’, 1997) see also; Festo Kivengere, ‚ÄúForce and Power‚Äù, in Justice, Reconciliation and Peace in Africa, by David W. Shenk, Revised edition (Nairobi: Uzima Press, 1997), 169–72.
Nous avons interrogé les responsables de la CMM sur ‘Renouveau’.
- Comment pourrions-nous, en tant qu’anabaptistes-mennonites, rechercher le renouveau à ce stade de notre histoire ?
- Quels changements devrions-nous peut-être apporter ?
- Quels risques devons-nous être prêts à prendre ?
- Pouvons-nous être aussi radicaux que l’étaient les premiers anabaptistes en leur temps ? Voudrions-nous l’être ?
- Le renouveau est généralement perturbateur, mais peut-il être non violent ?
- De quelles stratégies ou positions avons-nous besoin pour relever le défi d’être une famille anabaptiste mondiale unie aujourd’hui ?
Qu’en pensez-vous ?
Joignez-vous à notre conversation ! Ajoutez vos propres réflexions ci-dessous ou envoyez-nous un courriel (info@mwc-cmm.org).
Contributeurs :
- Andrés Pacheco Lozano, Commission Paix, secrétaire (Colombie/Pays-Bas)
- Anicka Fast, Commission Foi & Vie, secrétaire (Canada/Pays-Bas/Burkina Faso)
- Andi Santoso, Commission Diacres, président (Indonésie/États-Unis)
- Henk Stenvers, Comité Exécutif, président (Pays-Bas)
- Lisa Carr-Pries, Comité exécutif, vice-présidente (Canada)
- Sunoko Lin, Comité Exécutif, trésorier (Indonésie/États-Unis)
- Thomas R Yoder Neufeld, Commission Foi & Vie, président (Canada)
- Tigist Tesfaye, Commission Diacres, secrétaire (Éthiopie)