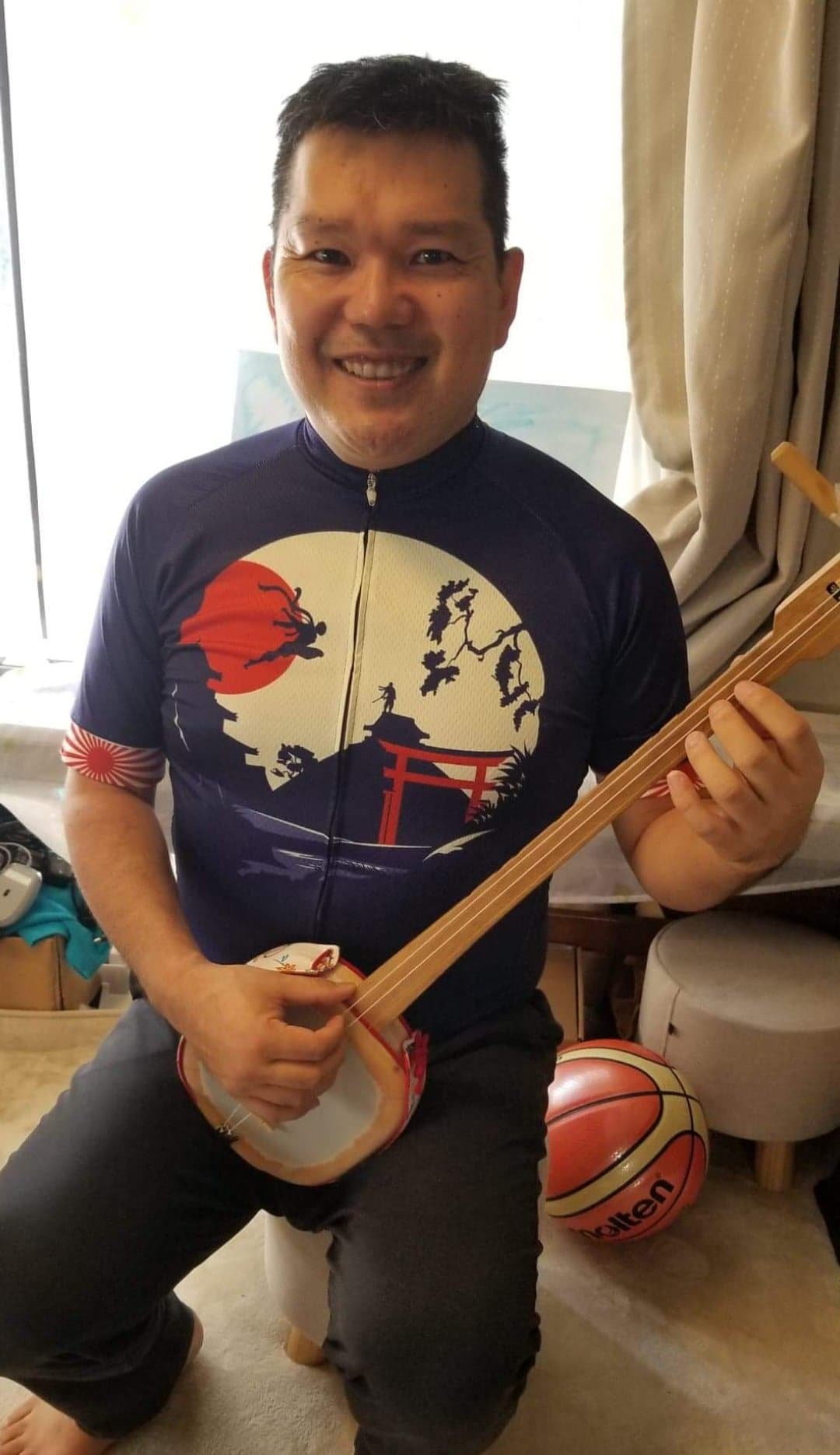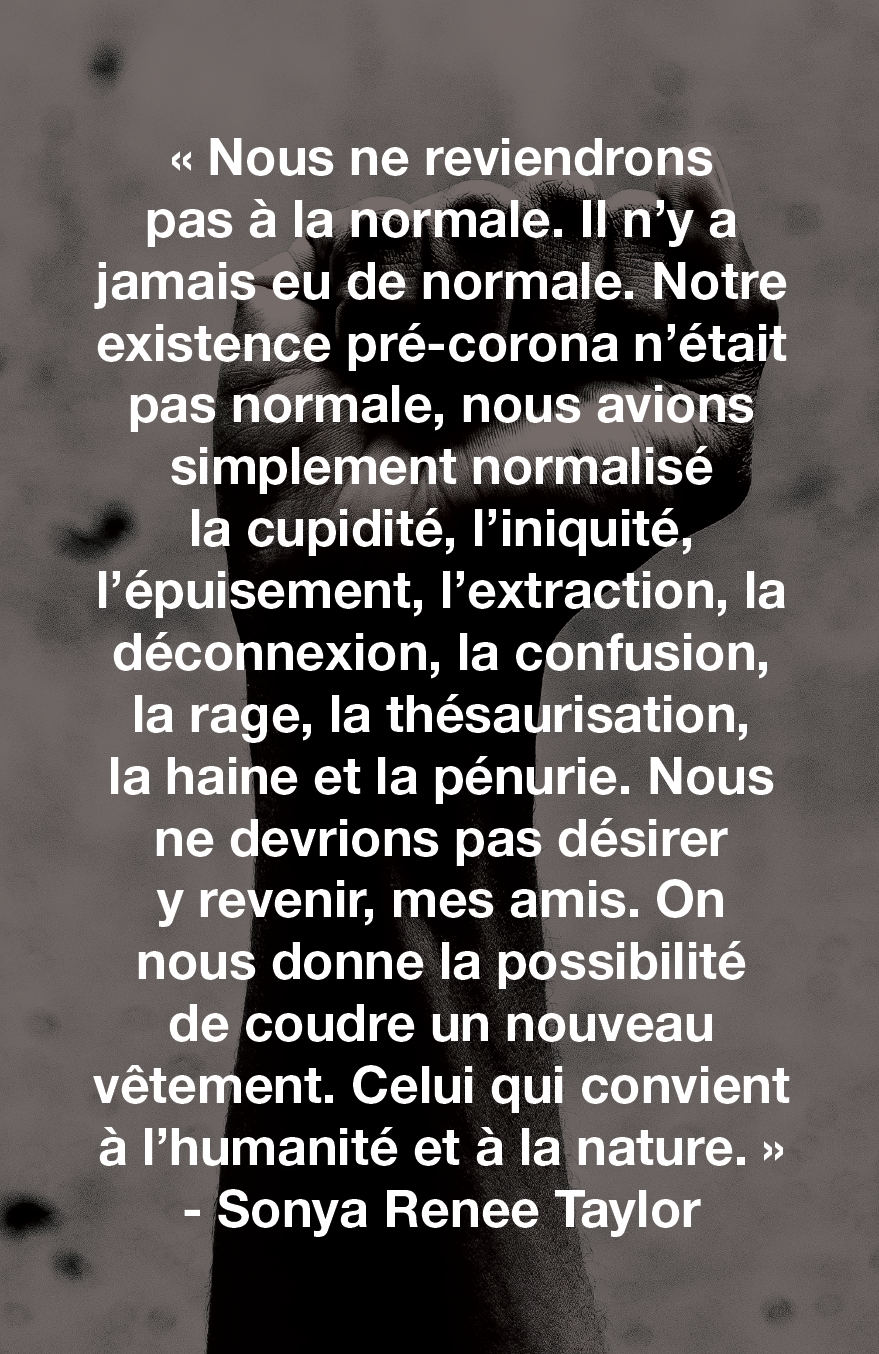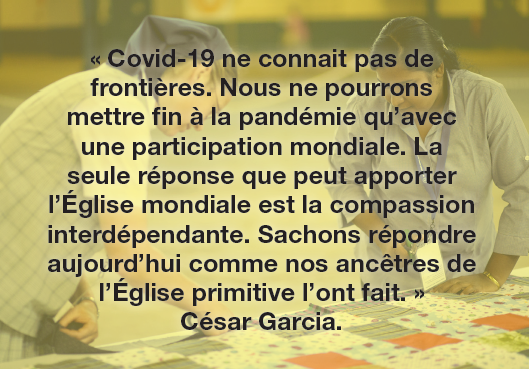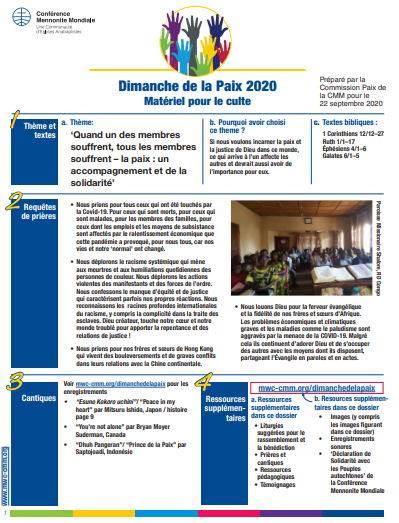Contexte de la lettre
L’auteur
Paul écrit cette lettre d’une grande profondeur. Nous ne nous attardons pas souvent sur les conditions dans lesquelles fut écrite l’épître aux Philippiens, mais il est important d’analyser le contexte de vie de l’auteur pour pouvoir comprendre ce qui a motivé ses paroles et quelle était son intention.
Paul a été mis en prison, non parce qu’il a attenté à l’ordre publique ou à la vie d’autrui, mais à cause de l’évangile et de sa fidélité au projet de Dieu. C’est parce qu’il a obéi à l’appel de sa vocation qu’il se trouve dans cette situation très difficile, au fond d’un cachot. Paul est dans l’attente de son jugement. L’avenir l’angoisse tellement qu’il dit que pour lui ‘mourir est un gain’ (Philippiens 1/20-24). Pour les prisonniers vivant dans des conditions pareilles, la mort peut sembler préférable, car il est bien difficile de trouver un sens à la souffrance pour continuer à vivre. La conviction de Paul concernant sa mission et le sens de sa vie lui permet de surmonter sa souffrance et de voir plus loin pour que la mission puisse continuer malgré les circonstances (1/12-14).
Paul mentionne deux personnes qui l’accompagnent durant ces moments difficiles : l’un est Timothée (Philippiens 1/1) et l’autre Épaphrodite (2/25) qui a été envoyé par l’église pour aider Paul.
Le contexte
Dans certains écrits littéraires du Ier siècle on trouve des descriptions des prisons de l’époque. C’était des espaces exigus, peu aérés, surpeuplés, sombres, sales et peu hygiéniques. Les détenus étaient soumis à des tortures physiques et psychologiques, avec les menottes aux mains, aux pieds et au cou, certains dans des positions cruelles, et d’autres liés à un soldat. Les exécutions étaient souvent retardées pour prolonger le martyr des prisonniers qui vivaient dans l’attente de savoir quand ils seraient exécutés (Philippiens 1/20). Les prisonniers les plus prestigieux bénéficiaient de conditions un peu meilleures et n’étaient pas enchaînés. Mais selon le témoignage d’Actes 16 (Actes 16/22-24), Paul n’appartenait pas à cette catégorie. Cela peut nous aider à imaginer ce que Paul ressentait lorsqu’il a écrit cette lettre.
Les destinataires
Elle est adressée à l’église de Philippes, principalement aux évêques et aux diacres, et aux personnes intéressées. L’usage de mots comme ‘évêques’ et ‘diacres’ révèle que cette église avait une organisation et une structure. Elle est sans doute influencée dans sa structure par d’autres groupes grecs (1/1-2). Elle a été fondée par Paul et il s’en sent très proche (4/1). Cette lettre est pleine d’éloges, de paroles d’amour et d’amitié (1/3,12). Paul appelle à être dans la joie, et cela nous interpelle : comment Paul peut-il appeler à la joie et encourager ses correspondants à être dans la joie, alors que lui se trouve dans une situation pareille ? Une autre question surgit également : cette paroisse, qui remplit Paul de fierté, n’était-elle pas en train de passer par des difficultés qui lui faisaient perdre sa joie ? Est-ce pour cela que Paul l’exhorte à la retrouver et à la conserver ?
Aimer quelqu’un avec qui on a une histoire commune, des expériences, des joies et avec qui croissance mutuelle, peut pousser à sortir de soimême et à penser aux autres, même dans une situation très douloureuse ou risquée, comme c’était le cas pour Paul. C’est pour cela que Paul n’est pas préoccupé par le lieu où il se trouve ou par sa mort probable, ni même par sa souffrance quotidienne ; son souci pour les autres le pousse à écrire pour les encourager à continuer jusqu’à ce qu’ils atteignent leur but (3/12-15).

J’aimerais souligner trois préoccupations importantes de Paul dans cette lettre.
-
Se garder des religieux qui imposent des rites (juifs) comme si c’était plus important que de suivre Jésus (3/1-10) ;
-
Rester joyeux dans le Seigneur (3/1) ;
-
Manifester sa reconnaissance pour tous ceux qui l’ont soutenu durant ces temps difficiles en envoyant Épaphrodite (2/25-30).
Ê partir de ce prisme nous pouvons aborder le verset qui a été choisi cette année et y trouver les caractéristiques importantes de cette paix qui surpasse tout intelligence.
Philippiens 4/6-7
Introduction
Quelles conditions extrêmes dans la vie peuvent nous amener à expérimenter la paix de Dieu ?
Reina est une Camerounaise qui a entrepris un long voyage depuis son pays pour vivre le ‘rêve américain’, ce fameux rêve recherché par tant de personne qui pensent qu’ils trouveront aux ÉtatsUnis une vie d’abondance et de bien-être. Elle est d’abord arrivée au Brésil où elle a pu rester et travailler un an et demi, ce qui lui a permis d’économiser et de pouvoir continuer vers les États-Unis. Elle raconte que cela a été très difficile parce qu’elle ne parlait pas portugais, mais elle a appris, et à grâce à ses talents, elle a pu travailler dans la tapisserie. Elle est ainsi parvenue à amasser une petite somme d’argent et à se faire quelques amis.
Elle a traversé différents pays d’Amérique latine où elle a rencontré bien des obstacles, a dû faire face au danger et elle a aussi souffert de la faim. Bientôt l’argent est venu à manquer et elle a appelé une amie au Brésil pour qu’elle lui prête 100 dollars qu’elle a promis de lui rembourser lorsqu’elle arriverait aux États-Unis. Elle a pu continuer sa route et est finalement arrivée. Le chemin a été long et périlleux. Au Panama, on ne lui a donné qu’une heure pour traverser le pays, et elle a été déporté plusieurs fois jusqu’à ce qu’elle y parvienne.
Pour elle, le pays le plus dangereux a été la Colombie. La guérilla et la traversée de lieux abandonnées ont été très dangereux et elle a vu beaucoup de personnes mourir. Au Nicaragua, elle a été volée et elle n’avait plus qu’une poignée de riz à manger, donnée par ceux qui ont eu pitié d’elle. Au Mexique elle a eu l’aide de personnes compatissantes, mais il lui a aussi fallu faire très attention dans certains endroits. Quand finalement elle est arrivée à la frontière, elle a demandé l’asile et a été mise dans un centre de détention où elle est restée un an (Centre de détention GEO à Aurora, Colorado).
Là, elle n’a manqué de rien, elle a mieux appris l’espagnol et l’anglais, mais c’était difficile car elle n’avait ni famille ni avenir. Sa régularisation n’avançait pas parce qu’elle n’avait aucun papier d’identité. Elle pensait qu’on lui avait tout volé pendant le voyage. Cependant, sa foi augmentait et elle avait l’espoir que Dieu seul pouvait l’aider
Une inconnue, Maria, qui vit aux Etats-Unis, lui a proposé de l’aider. Mais Reina avait besoin d’une pièce d’identité. N’en n’ayant pas, Reina lui a demandée de lui rendre un seul service : qu’elle appelle son amie au Brésil pour lui dire qu’elle n’a pas oublié sa dette, et que lorsqu’elle quittera le centre de détention, elle travaillera pour la rembourser. María a donc téléphoné au Brésil et lorsqu’elle a expliqué la situation de Reina, elle a été surprise d’apprendre que Reina avait laissé ses papiers d’identité au Brésil ! C’était un miracle ! Reina a été libérée pour continuer ses démarches de demande d’asile politique.
Lorsqu’elle raconte son histoire, Reina utilise beaucoup l’expression ‘seul Dieu..’. Elle répète à chaque étape de son périple : ‘seul Dieu sauve, guérit, protège, aime, libère… Elle le dit avec beaucoup d’assurance et de conviction, et ses yeux pétillent de joie, de surprise et d’admiration en se rappelant les interventions miraculeuses de Dieu dans chaque situation. Il n’y avait aucune explication humaine, seulement une foi sincère dans le Dieu auquel elle croit.
Comment avoir une telle paix au sein de tant de souffrance ?
Non seulement ces personnes sont en paix, mais elles incitent les autres autour d’elles à vivre et à l’expérimenter. Mais, comment être dans la paix ?
I. Un appel à vivre cette paix qui dépasse toute intelligence
Paul est en prison, enchaîné, dans des conditions que la plupart d’entre nous n’avons jamais connu. Dans n’importe quelle situation extrême, on peut observer deux types de réactions : a) être victime ‚Äì se tourner vers soi et s’apitoyer sur son sort, raconter aux autres tout ce que l’on souffre afin qu’ils s’en rendent compte, agissent et se mobilisent, ou b) se prendre en main et agir soi-même pour changer la situation. On peut agir pour soi et pour ceux qui sont sans soutien.
Les situations limites développent l’incertitude et la peur de l’avenir (physique ou psychique). Pourtant, l’amour pour autrui, que ce soit la famille, les amis, l’église, etc. fait que l’on arrive à dépasser sa situation et à en tirer des leçons profondes pour nous-mêmes et pour les autres. C’est la présence de Dieu qui nous ressource et nous guide en produisant la paix que l’on éprouve lorsque l’impossible devient possible, une paix qui, malgré les circonstances, peut générer la confiance, la sécurité, le salut et le bien-être.
Les chaînes, la surveillance des soldats, l’espace réduit de la cellule, l’incertitude de l’exécution, de la vie et de la mort, n’empêchent pas Paul de lever les yeux, de voir ses frères bien-aimés de Philippes et de s’en préoccuper
II. D’où vient cette paix profonde ?
Accompagner avec amour et amitié
Paul est accompagné par Timothée ; il nous parle de lui à différents moments et circonstances, y compris alors qu’il est en prison. Il semble que le fait d’être prisonnier lui permette tout de même d’avoir Timothée près de lui. Il reçoit également Épaphrodite (3/25-27) qui représente l’église de Philippes. Celui-ci lui fait parvenir des produits de première nécessité et lui transmet l’affection de l’église (4/15-17).
Se réjouir (4/4-5)
La situation de Paul ne l’empêche pas de se réjouir en se souvenant de son église bien aimée et il lui demande également qu’elle se réjouisse dans le Seigneur. Il insiste : ¬´ je le répète, réjouissez-vous ¬ª cette insistance est un appel être attentif à la joie. Les chaînes ne peuvent empêcher de se réjouir de la relation profonde avec des personnes qui sont loin.
Ne pas se faire de souci mais prier (4/6)
Paul pourrait faire part de ses soucis, pourtant il fait tout le contraire. La lettre montre un Paul qui, au milieu de l’adversité, fait pleinement confiance à Dieu. En dépit de circonstances difficiles et d’un avenir incertain, il a confiance et garde sa foi en Dieu.
Tout ceci nous permet de vivre la paix profonde qui surpasse toute intelligence.
III. La paix incomparable
Le verset 7 commence par ‘Et’ pour décrire ce qu’est réellement l’expérience de la paix qui surpasse toute intelligence.
Ici, ‘Et’ signifie accompagner avec amour et amitié, se réconcilier, exprimer la joie, ne pas se faire de souci mais prier. Et ainsi on peut vivre cette paix.
C’est dans les circonstances les plus difficiles que nous parvient cette déclaration : la prison pour Paul, le parcours de Reina à travers l’Amérique latine au péril de sa vie, les anabaptistes du XVIe siècle qui chantaient face à la mort, et d’autres personnes du passé qui, de près ou de loin, nous montrent par leur vie que la paix surpasse toute intelligence.
Conclusion
Aujourd’hui dans tous les pays, des personnes passent par des situations extrêmes. Ce merveilleux passage nous interpelle à vivre cette paix qui surpasse toute intelligence et maintient nos c≈ìurs en Jésus Christ, notre Seigneur.
Quelles situations extrêmes traversez-vous, dans lesquelles vous connaissez la paix profonde de Dieu ?
Témoignez de cette paix qui dépasse toute intelligence dans les crises et les conflits de la vie.
—Rebeca González Torres (Mexico)
Cet article fait parti du materiel pour le culte du Dimanche de la Paix de 2019. Pour en savoir plus, cliquez ici.