La Conférence Mennonite Mondiale a engagé un premier dialogue officiel avec l’Alliance baptiste mondiale en1989. Depuis, la CMM a entre tenu des conversations avec la Fédération luthérienne mondiale, les adventistes du septième jour, les catholiques et, plus récemment, avec les catholiques et les luthériens dans le cadre d’un dialogue trilatéral de cinq ans. En raison de la valeur de ces dialogues, la Commission Foi et Vie a élaboré ce document pour permettre aux conférences nationales des églises et aux assemblées locales de la CMM de mieux comprendre le fondement théologique de l’hospitalité œcuménique, et pourquoi nous pensons que ces conversations sont conformes aux valeurs anabaptistes. Le document a été approuvé comme ressource pédagogique de la CMM par le Conseil Général de Limuru, au Kenya, en avril 2018.
Lorsque nous parlons de l’Église mondiale du Christ dans le contexte de la Conférence Mennonite Mondiale, la première lettre de Paul à l’église de Corinthe apporte un élément de référence utile. Au chapitre 13, qui traite du thème de l’amour, Paul reconnaît que toute connaissance humaine–même chrétienne, théologique ou confessionnelle, est limitée. En faisant de la théologie, nous connaissons seulement « en partie » (1 Corinthiens 13/9), nous voyons la vérité « dans un miroir » (1 Corinthiens 13/12). Notre connaissance et notre capacité à comprendre sont toujours influencées par notre point de vue. Dans la présence éternelle de Dieu, ce sera différent (1 Corinthiens 13/12). Mais pour l’instant, nous devons nous contenter de cela. Dans nos trajectoires d’êtres humains, limitées parle temps, l’espace et nos cinq sens, notre connaissance est toujours partielle et notre compréhension de la Vérité est façonnée par notre contexte et notre point de vue personnel.
C’est pourquoi nous devons être prévenants, patients, empathiques et, surtout, aimants avec les autres. « Les prophéties, dit Paul, elles seront abolies… Ê présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse…Ma connaissance est limitée, alors, je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc ces trois-là demeurent : la foi, l’espérance et l’amour. Mais l’amour est le plus grand. » (1 Corinthiens 13/8-13)
Ainsi, chaque fois que des chrétiens de traditions théologiques différentes se rencontrent et dialoguent, nous devons le faire dans l’esprit des trois grandes vertus chrétiennes qui de meurent. Paul note également qu’en tant que chrétiens nous parlons différentes langues – littéralement et aussi sur le plan de nos identités théologiques, de nos développements historiques et de nos contextes variés. « Il y a je ne sais combien d’espèces de mots dans le monde, écrit Paul, et aucun n’est sans signification. Or, si j’ignore la valeur du mot, je serai un barbare pour celui qui parle, et ce lui qui parle sera pour moi un barbare. » (1 Corinthiens 14/10-11)
Ce sont de véritables limitations. Mais reconnaître cela peut aussi devenir une expérience libératrice – je suis libre de réaffirmer mon identité et mon point de vue, car « c’est le seul que j’ai ». Mais je suis également libre de reconnaître la possibilité que les autres aient leurs propres compréhensions, leur propre point de vue, leurs propres limites historiques et contextuelles. Et c’est aussi libérateur de savoir que tout cela peut se faire dans l’esprit et le pouvoir de « la foi, l’espérance et l’amour ».
1. Nous avons besoin d’une identité de confession chrétienne
On peut déplorer la scission de l’église chrétienne en autant de confessions et de traditions. Mais cette réalité, après 2000 ans de christianisme, n’est pas forcément une mauvaise chose, tant que nous nous souvenons de la prière du Seigneur pour l’unité des chrétiens dans Jean17. En effet, les identités confessionnelles peuvent être utiles et aussi nécessaires :
1.1. Aucune église ou confession n’est capable de saisir toute la richesse de Dieu; la diversité est essentielle pour construire l’unité. Pour que le corps fonctionne bien, l’œil doit être un œil; l’oreille doit être une oreille; la main doit être une main (1 Corinthiens 12/15-20). Si ces différences sont abolies, le corps ne peut pas survivre.
1.2. Tout au long de l’histoire, les confessions ont contribué à appliquer la règle de l’Évangile à des situations spécifiques. Par exemple, à une époque où l’église était riche et mêlée à la politique, les franciscains voulaient vivre radicalement les paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne. Ê une époque où certains chrétiens payaient pour le pardon des péchés, Luther a redécouvert l’Évangile de la grâce gratuite. Les anabaptistes ont osé insister sur la pratique biblique du baptême volontaire et de la non-violence, rompant avec le statu quo adopté par les églises d’État catholiques et protestantes, même au prix de sévères persécutions et d’exils. Les méthodistes ont surgi à une époque où un réveil était grandement nécessaire; et les pentecôtistes sont apparus dans un contexte de discrimination raciale et de rigidité institutionnelle.
1.3. Les confessions chrétiennes apportent des correctifs : à ses débuts, chaque confession a émergé pour corriger des problèmes spirituels ou éthiques dans l’église. C’est pourquoi les confessions doivent rester flexibles. Ce qui était vrai et nécessaire à un moment donné peut devenir mauvais et inutile dans un contexte historique ou culturel différent. C’est arrivé au peuple d’Israël avec le serpent d’airain : un symbole du salut pendant un temps qui deviendra plus tard un objet d’idolâtrie. C’est pourquoi les confessions doivent être ouvertes au renouveau – pour corriger ce qui ne va pas et aborder les éventuels manques bibliques – si elles veulent rester fidèles à l’esprit de leurs mères et de leurs pères fondateurs.
1.4. Chaque confession est porteuse de dons et de grâces spécifiques qui doivent être partagés au bénéfice de tous. Le « banquet » chrétien interconfessionnel est un véritable et merveilleux cadeau pour l’Église mondiale parce que nous pouvons apprendre tellement les uns des autres : l’érudition des jésuites, par exemple, ou le style de vie simple des franciscains ; le mysticisme centré sur le Christ de Meister Eckhart, de Jean de la Croix et de Gerhard Tersteegen ; le zèle pour la mission, l’éducation chrétienne et la spiritualité des piétistes ; le biblisme, la non-violence et les convictions de l’église des croyants anabaptistes ; sola fide, sola gratia et sola scriptura des luthériens ; la souveraineté et la gloire de Dieu de la tradition calviniste ; la « méthode » chrétienne des méthodistes ; l’évangélisation personnelle des baptistes ; le discernement communautaire des quakers ; la simplicité des amish ; la dimension transcendantale du pouvoir divin des pentecôtistes ; le royaume « inversé » des communautés latino-américaines, etc.
Par conséquent, ce n’est pas l’uniformité, mais la diversité qui contribue à l’édification du corps unique du Christ (Éphésiens 4/1-16).
2. Nous avons besoin d’une œcuménicité centrée sur le Christ
Les églises et les confessions ne doivent pas rester seules et isolées les unes des autres. Elles ont besoin de l’hospitalité et du dialogue interéglises.
2.1. Les églises devraient célébrer le corps unique du Christ. Éphésiens4/4-6 nous rappelle qu’il n’y a qu’un seul Esprit, un seul espoir, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Père divin. Quand le Christ reviendra, les gens de « toutes les nations, tribus, peuples et langues » s’uniront pour former une communauté de louanges pour l’accueillir (Apocalypse 7/9). D’autres passages des Écritures affirment qu’il n’y a qu’une seule « épouse de l’Agneau » (Apocalypse 19,7), un « peuple de Dieu » (1 Pierre 2/9-10), une «famille spirituelle » (Galates 6/10), un «corps du Christ » (Romains 12/5), un « royaume des cieux » (Matthieu 16/19). Au-delà là de l’histoire des confessions chrétiennes, l’Église est une unité existentielle unie par sa rédemption dans le Dieu trinitaire.
2.2. Cela signifie qu’en tant qu’enfants de Dieu, nous sommes tous « frères et sœurs » . Éphésiens 3/14-15 nous informe que notre parenté commune avec Dieu fait de nous une famille. Le dicton « vous pouvez choisir vos amis, mais vous ne pouvez pas choisir votre famille » est valable pour les relations interéglises : quiconque appartient à Christ est mon frère ou ma sœur. D’un point de vue éternel, il n’y a pas de « cousins germains », de « cousins au second degré » ou de « parents éloignés » dans la « maison de Dieu ».
2.3. Des églises et des traditions distinctes peuvent potentiellement se compléter. Romains 12/4-5 et 1 Corinthiens12/12-20 insistent sur le fait que les membres d’un même corps sont différents, mais que leur diversité permet au corps de fonctionner comme il se doit. Bien s√ªr, tous les membres ne sont pas égaux par leur nature et leur fonction : une tête coordonne un travail divin. Pourtant, pour que le corps fonctionne, les différences entre les membres sont essentielles. Personne ne peut négliger un autre membre du corps de Christ comme s’il pouvait se passer de lui. Personne ne possède tous les dons nécessaires. Le corps est bien plus qu’une oreille, une bouche ou des yeux. C’est vrai aussi bien pour l’église locale que pour le parcours commun de différentes traditions chrétiennes.
2.4. Les églises sont appelées à s’entraider et à se construire l’une l’autre. Les membres faible sont besoin des forts ; et il y a des moments où la faiblesse ou la vulnérabilité d’un membre du corps révèle le caractère du Christ. Comme l’écrit Paul, « même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c’est à eux que nous faisons le plus d’honneur. » (1 Corinthiens 12/22-23)
Conclusion
Dans la famille de Dieu (ecumene), nous devons être prêts à vivre une « diversité réconciliée » , en étant à la fois courageux en revendiquant l’héritage et la contribution de notre confession, et humbles en reconnaissant que notre compréhension est limitée.
Toute vérité que Dieu a placée dans les différentes confessions et leur histoire doit être entendue, préservée et articulée. Les minorités ne devraient pas être dominées par les majorités. Alors même que nous reconnaissons la diversité comme saine, il y a aussi un besoin d’humilité. Dans nos histoires confessionnelles spécifiques, tout n’est pas bon, biblique et agréable à Dieu. De nombreuses divisions auraient pu être évitées. Maintes mémoires doivent être guéries. De nombreuses condamnations appellent à la repentance et à la réconciliation. Les péchés et les erreurs du passé doivent être confessés et pardonnés. Après tout, l’Église a reçu le ministère de la réconciliation (2 Corinthiens 5/18-19). Et si notre témoignage veut être crédible pour le monde qui regarde, le travail de réconciliation doit commencer dans la « maison de Dieu » (Ephésiens 2/19). S’engager pour le ministère de réconciliation prendra sans doute plusieurs formes. Dans certains cas, cela peut signifier une unité complète et formelle dans tous les aspects de la vie d’église ; avec d’autres groupes, il peut s’agir simplement d’une unité fonctionnelle, dans laquelle nous acceptons de collaborer sur un nombre limité d’initiatives. Mais dans tous les cas, notre orientation ecclésiale ira dans le sens de la réconciliation plutôt que dans celui d’une identité ancrée principalement dans nos différences.
Alfred Neufeld Friesen d’Asunción(Paraguay), est président de la Commission Foi et Vie de la CMM, et ancien de l’Église des frères mennonites. Il est président de l’Universidad Evangélica del Paraguay (université protestante) (au moment de la rédaction de cet article).
«Œcuménicité» est compris ici comme une tendance et une bonne volonté à l’égard du dialogue et de la coopération avec les autres confessions chrétiennes ou traditions d’église. Le mot « œcuménicité » provient du grec oikos (maison) et menein (habiter) et équivaut à « l’entière famille chrétienne qui habite dans la maison de Dieu. »
1 Corinthiens 13/12 : « dans un miroir » – signifie littéralement « comme une énigme » du grec ainigmati.
23 juillet 1955–24 juin 2020
La Conférence Mennonite Mondiale (CMM) a perdu Alfred Neufeld Friesen, auteur prolifique, théologien, historien, enseignant et grande influence dans le domaine de la théologie anabaptiste au niveau mondial. Il est décédé le 24 juin 2020 à Münster, en Allemagne où il était hospitalisé pour un cancer du foie et des problèmes rénaux.





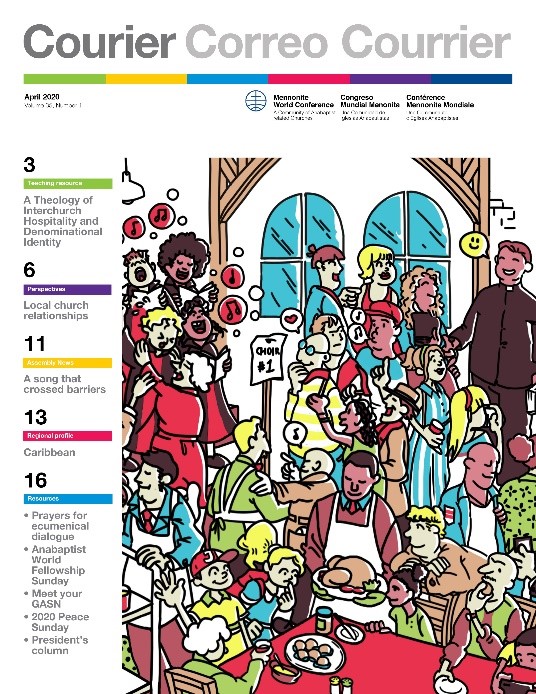


 De 1978 à 2018, environ cinquante missionnaires ont donné leur vie, leur temps et leur talent pour apporter l’Évangile du salut aux populations du Kénédougou. La mission a atteint les peuples Tagba et Dzunn qui se sont appropriés la Parole de Dieu comme étant les premiers destinataires.
De 1978 à 2018, environ cinquante missionnaires ont donné leur vie, leur temps et leur talent pour apporter l’Évangile du salut aux populations du Kénédougou. La mission a atteint les peuples Tagba et Dzunn qui se sont appropriés la Parole de Dieu comme étant les premiers destinataires.





