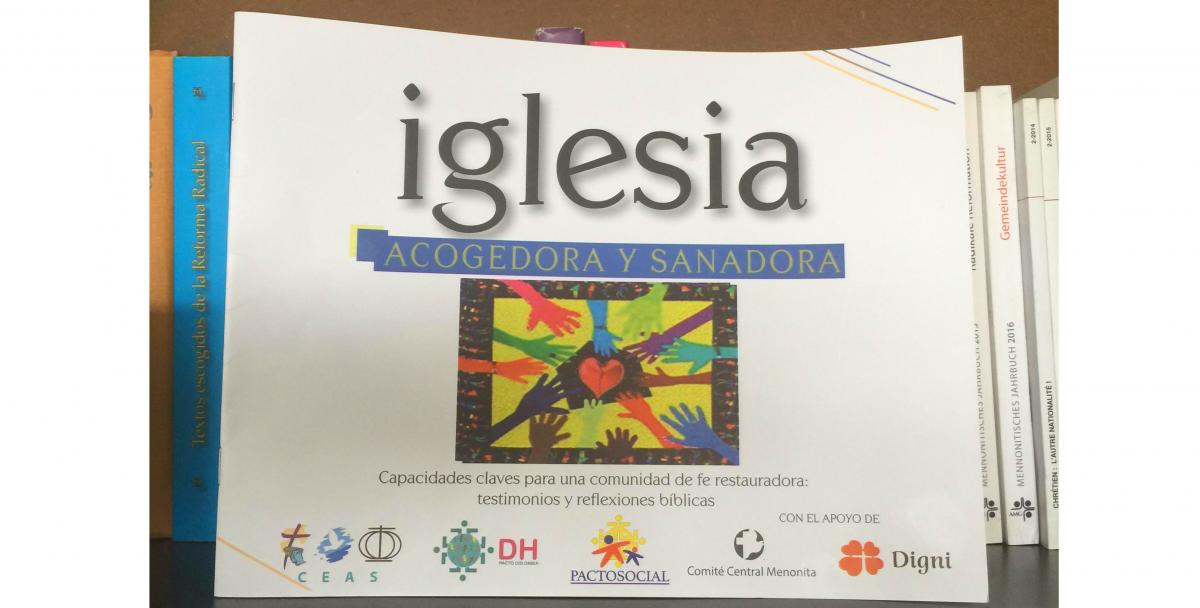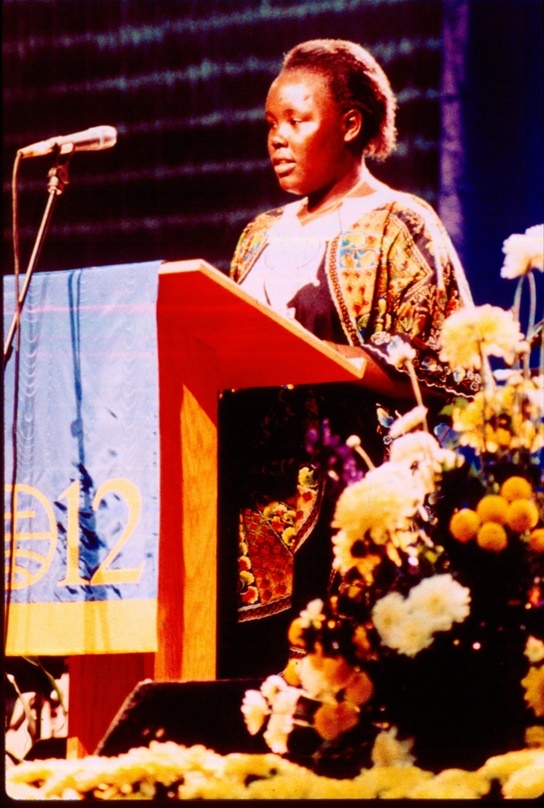En ce début de troisième millénaire, l’humanité fait face à de sérieux problèmes écologiques qui menacent la vie de l’homme et de toute la création. Les conséquences du réchauffement climatique sont perceptibles dans tous les pays du monde : la pollution de l’air et de l’eau, les fortes inondations et les grandes chaleurs, etc.
En Afrique, principalement dans les pays au sud du Sahara, les populations sont exposées à de multiples maladies à cause de la dégradation de la création et des conditions de vie. Les autres créatures, telles que les poissons, les animaux, tant domestiques que sauvages, les oiseaux, les arbres et rivières, ne sont pas épargnées. Elles sont victimes de la cupidité et de la folie humaines. Or, de même que le Seigneur nous garde, nous devons garder la création de Dieu, en prenant soin de la terre et de ses habitants ; telle est la volonté du créateur.
- La Bible et la sauvegarde de la création
La Bible n’est pas muette concernant la responsabilité de l’homme à l’égard de la création. Elle est riche de leçons dans ce domaine au point que plusieurs ont été amenés à considérer la parole de Dieu comme une sorte de livre d’écologie, un manuel qui aide les chrétiens à vivre correctement sur la terre, un manuel qui nous indique « comment vivre sur la terre pour n’être pas désorientés en arrivant au ciel » (Dewitt).
- Fondement vétérotestamentaire
L’Ancien Testament contient plusieurs passages bibliques qui nous renseignent sur notre responsabilité à l’égard de la création. Toutefois, le passage le plus éloquent, est celui de Gn 2/15 « l’Éternel prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder ». Ce verset pose le fondement biblique de la protection de la création. Il souligne le mandat culturel de la mission de Dieu confiée à l’homme dans le jardin d’Eden. Ce double mandat missionnaire consiste à cultiver et garder. Parlons-en succinctement :
Cultiver – àvàd

Étymologiquement, ce mot tire son origine de la racine àvàd qui signifie cultiver, servir, travailler. Dans tout l’Ancien Testament àvàd n’a que ces deux significations qui reviennent au même : honorer et glorifier Dieu.
Dans le premier cas, il s’agit de rendre un culte à Dieu, d’accomplir certains services dans l’adoration. Le second a trait au travail manuel de l’homme pour subvenir à ses besoins ou pour le compte de leur maître, dans le cas des esclaves. C’est aussi un service que l’on rend aux rois (Ex 20/9, 30/16, Lv 25/39, Dt 28/23, Ps 128/2, 24/1-2, Ac 20/35, 1 Co 16/58, 2 Th 3/8–9,11).
Dans cette perspective, l’homme n’est pas créé pour ne rien faire. Le travail est une nécessité de sa nature, qui ne peut se développer que par le moyen de l’activité. C’est le travail qui développe l’intelligence, l’ingéniosité, toutes les forces de l’énergie et de la volonté, aussi bien que celles du corps (Rochedieu). L’homme est d’abord appelé au travail, puisque c’est la condition sine qua none de tout développement. L’homme continue l’œuvre de Dieu par le travail. L’homme et la femme vit pour travailler, car Dieu veut qu’ils soient prospéres. L’apôtre Paul dit même que « celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus » (2 Th 3/10).
Il sied de souligner qu’au début, le travail manuel n’est ni une malédiction ni la conséquence du péché. Il est une institution divine. Le travail vient de Dieu, car, lui-même a travaillé et travaille encore.
Le terme àvàd, compris comme service à rendre, renvoie aussi au culte que l’homme doit rendre à Dieu. Or le véritable culte consiste à se mettre au service des autres pour le bien (Es 58/6-7 ; Jc 1/27) ; cultiver signifie obéir à la volonté et aux prescriptions de Dieu. Rochedieu estime à ce sujet « qu’il y a dans ce cas une étroite analogie entre cultiver, culte et culture. Le bon usage de la mission conduit nécessairement au service à rendre à Dieu pour sa gloire et son honneur et pour le bien-être et l’intégrité de toutes les créatures, il demande à Dieu son pain tout en se mettant au travail pour l’obtenir » .
Dieu a placé l’homme dans le jardin, non seulement pour le cultiver, mais aussi pour le garder.

Garder – shamar
Ce verbe signifie : garder, surveiller, veiller sur, protéger, conserver, retenir, conserver le souvenir, observer, remarquer, tenir. Ce verbe est utilisé 126 fois dans le pentateuque, 128 fois dans les prophètes et 165 fois dans les Écritures. Dans le passage de Gn 2/15, shamar prend le sens de surveiller, préserver, prendre soin.
De ce point de vue, la tâche de l’homme consiste à garder le jardin contre un ennemi d’une toute autre nature, qui aspire à s’en rendre maître et qui ne tardera pas à apparaitre. Cette tâche d’Adam qui ne se rapportait qu’au jardin, laisse entrevoir celle de l’humanité à l’égard de la terre.
Le mot garder shamar se réfère tant aux bergers qui veillent sur le troupeau (1 S 17/20) qu’au fermier qui prend soin du jardin comme dans Gn 1/28 et 2/15, « l’humanité a été responsabilisée » (Roop).
« La mission confiée par Dieu ne s’accomplit pas dans l’exploitation et la destruction de la flore et de la faune, » ecrit professeur d’ethique Jochem Douma. « Bien au contraire, l’homme n’a pas seulement affaire à des ‘ choses’ qu’il peut manipuler et déformer selon son bon plaisir pour s’enrichir, il a reçu l’administration d’une fonction déterminée par Dieu. Il s’ensuit que l’homme doit se comporter avec les autres créatures en tenant compte des caractéristiques que Dieu a accordées à chacun. »
En tant qu’administrateur de grands biens, l’homme ne saurait prétendre passer devant pour être le propriétaire. Le monde est une création de Dieu et non de l’homme. Il est seulement le gérant d’une création qui reste la propriété de Dieu. Elle doit être gérée selon les normes de la justice divine et non selon celles que l’homme forge dans son désir de puissance.
De nos jours, la création connait une dégradation à grande échelle qui ne doit pas laisser indifférents ceux qui s’appellent disciples de Jésus-Christ, car la survie de l’humanité actuelle et celle des générations à venir en dépend.

Fondement néotestamentaire
Plusieurs passages du Nouveau Testament parlent de la dimension cosmique de l’Évangile. Nous n’examinerons cependant que les textes des épitres de Paul aux Colossiens (1/15-23) et aux Romains (8/18-22).
Le passage Col 1/15-23 affirme clairement qu’en Christ, tout (panta en grec) subsiste, parce que « tout a été créé par et pour lui » . Il décrit le lien qui existe entre le Christ de la création et le Christ de la croix. Il est celui en qui toutes choses sont réconciliées et retrouvent l’harmonie. Paul déclare hardiment que les bénéficiaires de cette harmonie retrouvée ne sont pas seulement les hommes, mais toutes choses. Cela est un acquis présent et futur.
Dans Rm 8/18-22, Paul écrit que toute la création souffre (les êtres humains et les autres créatures), et elle attend le jour de la rédemption des fils de Dieu. Cette souffrance vient de la rébellion de l’homme contre la loi de Dieu. Car Dieu a créé un jardin luxuriant, productif, sans mauvaises herbes, un lieu de pleine santé et de vie, mais le péché a amené la maladie, la mort, les épines et les chardons. L’homme doit travailler dur pour gagner son pain car la terre nourricière est maudite. En l’espace de deux siècles (depuis le début de l’ère industrielle), l’espèce humaine a mis en question les fondements de la vie.

La création souffre et soupire les douleurs de l’enfantement à cause de l’activité humaine : la destruction des espaces naturelles et l’urbanisation, l’extinction des espèces, la détérioration des sols, la transformation des ressources naturelles, les déchets et les produits dangereux, la pollution à grande échelle, l’altération de l’équilibre planétaire, la dégradation humaine et culturelle, le réchauffement climatique, l’insalubrité dans les grandes villes des pays en voie de développement etc. Ce sont de graves maux dont souffre la création.
Or, le mandat que Dieu a confié à l’être humain consiste à cultiver et garder le jardin. Mais en réalité l’homme ne fait que cultiver et exploiter la terre sans se préoccuper du second volet du mandat culturel de garder le don de Dieu sachant que le vrai propriétaire du cosmos est Dieu qui a créé toutes choses pour sa gloire. Et s’il nous a donné les bienfaits de la création pour que nous en jouissions de manière responsable, nous devons veiller à ne pas porter atteinte à sa fécondité.
En revanche, si nous agissons selon l’enseignement biblique à ce sujet, nous vivrons heureux et nous offrirons aux générations futures un avenir radieux.
- Les avantages de suivre l’enseignement biblique sur la sauvegarde de la création
L’enseignement biblique sur la sauvegarde de la création a plusieurs avantages. Il nous permet de :
- Bannir l’ignorance face à notre responsabilité par rapport à la protection de la création. Plus nous sommes renseignés sur les dégradations et les destructions infligées à la terre de notre Seigneur, plus nous sommes obligées de revoir notre responsabilité comme gérants et administrateurs de notre planète et de ses habitants. Nous comprenons que Dieu est le créateur de tout l’univers (Gn 1/1), qui lui rend un témoignage éloquent (Ps 19) ; toute la création appartient à Dieu (Dt 10/14 ; Ps 24/1 ; 1 Co 10/26) qui l’aime et en prend soin, donnant eau et nourriture à toutes les créatures Ps 104 ; Ac 14/17), comme il a donné aussi le Christ Jésus (Jn 3/16). Nous sommes assurés que le seigneur nous bénit et nous garde (Ps 104 ; Nb 6/24–26).
- Accorder à nous-mêmes et au sol un repos sabbatique c’est-à-dire le temps du rétablissement et de la jouissance des fruits de la création de Dieu (Ex 20/23, Lv 25/26). Tout comme Dieu pourvoit aux besoins de ses créatures, nous devons le faire également, en leur permettant d’être fécondes et de se multiplier Gn 1/22 ; 28/17 ; 9/1–7), et ne pas ajouter ‘maison sur maison’ (Es 5/8).
- Participer aux efforts consentis par les uns et les autres pour arrêter les dégradations rapides de la création qui menacent le monde. Car les conséquences de ces dégradations sont dramatiques tant pour l’espèce humaine que les autres espèces.
- Ouvrer dans la perspective du développement durable, d’être appelés à travailler pour notre développement, sans compromettre celui des générations futures.
![La Iglesia Menonita Fuente de Vida de Jac√≥ (Costa Rica), propose des ateliers gratuits o√π les enfants et les adultes font de l’artisanat à partir de matériaux recyclés. « Grâce à ces ateliers, nous essayons de sensibiliser le public à la protection de l’environnement dans le cadre de notre responsabilité [de chrétien] », dit la pasteure Sandra Campos. Photos : Sandra Campos](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==)
- Les co√ªts de la sauvegarde de la création
√Ä l’échelle planétaire, les gouvernements mondiaux sont divisés sur les questions liées à la protection de l’environnement. Les pays capitalistes et les pays les plus industrialisés du monde sont les plus grands pollueurs. Ils ne parlent pas le même langage quant à la question du réchauffement climatique, qui pourtant est une véritable menace pour l’avenir du monde. L’année passée (2017), les États-Unis, l’un des pays les plus industrialisés du monde, se sont retiré des accords de Paris sur le réchauffement climatique.
Les États les plus industrialisés doivent mettre de côté leur égo, changer leur vision du monde pour espérer changer la face du monde. C’est à ce prix que les moyens financiers peuvent être mobilisés pour arrêter les dégradations de la création dont les conséquences sont globales. Chaque État doit être conscient des sérieux problèmes écologiques qui menacent l’existence de la création.
En République Démocratique du Congo (RDC), la situation écologique est dramatique. En effet, depuis le génocide au Rwanda en 1994, l’est du pays a accueilli des milliers de réfugiés armés, qui ont saccagé la faune et la flore du pays. Les guerres successives ont contribué à la dégradation de l’environnement. Les parcs nationaux de Virunga et de Garamba sont devenus les repaires des groupes armés locaux et étrangers qui continuent à tuer les gorilles des montagnes, les okapis, les hippopotames, etc.
Dans les villes comme Kinshasa, la situation environnementale est dramatique : Kinshasa, appelée autrefois ‘Kin la belle’ est qualifiée par les Kinois eux-mêmes de ‘Kin la poubelle’ (Nzuzi). L’insalubrité règne partout. Les bouteilles en plastiques sont jetées partout, dans les caniveaux, les ruisseaux et les rivières. L’érosion a déjà emporté certaines parties des quartiers de la ville.
Cette insalubrité est à la base de maladies mortelles comme la typho√Øde, le paludisme, le choléra etc. Au moment o√π j’écrit, une épidémie de choléra sévit dans l’un des quartiers les plus défavorisés et peuplés de la ville de Kinshasa, le quartier Camp-Luka situé dans les communes de Ngaliema et Kintambo.
Face à cette situation, l’État congolais en général et le gouvernement provincial de Kinshasa en particulier, sont impuissants. Selon le gouverneur de la ville, le gouvernement provincial n’a pas les moyens financiers et matériels d’assurer l’assainissement quotidien de la ville. Les efforts consentis par le gouvernement et les personnes de bonne volonté sont une goutte d’eau dans l’océan.
Le co√ªt de la protection de la création exige à la fois des moyens financiers importants et le changement de mentalité des populations.
- La contribution des églises mennonites à la protection de la création en République Démocratique du Congo.
Les dégradations de la création en RDC sont étroitement liées aux cultures et aux besoins alimentaires et économiques des populations de chaque province. Par exemple, dans les régions du Kasa√Ø et du Sud-Ouest du Kwango, l’exploitation artisanale du diamant a complètement modifié la flore et l’hydrographie et certaines espèces animales sauvages ont complètement disparu.
Dans un tel environnement, les efforts des responsables mennonites consistent à conscientiser les membres et les populations locales au changement de mentalité et de la perception du monde vis-à-vis de la création, à la lumière de l’enseignement biblique.
Grâce au programme ‘Évangélisation et Santé communautaire’, les pasteurs et les membres des églises locales sont sensibilisés à travailler pour leur propre développement, mais aussi à la protection de la création et à la lutte contre l’insalubrité. Par exemple nous avons demandé à tous les pasteurs de Kinshasa d’assainir régulièrement la cour et l’environnement immédiat de leurs paroisses, de construire des installations hygiéniques dignes de ce nom et de planter des arbres dans la cour lorsque l’espace le permet. Après quelques visites effectuées dans différentes paroisses, ce travail est déjà efficace.
En outre, les jeunes mennonites s’associent à d’autres jeunes pour lutter contre l’insalubrité et les érosions de Kinshasa. Ce travail se fait avec les moyens du bord : sacs, bèches etc. Les années passées, grâce aux efforts de nos jeunes, les paroisses de Lonzo dans le quartier Camp-Luka, la commune de Ngaliema et la paroisse Mfila situées dans le quartier Delvaux de la même commune ont pu être sauvées des gigantesques érosions qui les menaçaient de disparition.
Conclusion
![« Cette photo me rappelle le Psaume 46:11 : ‘Arrêtez [cessez-immobilisez-vous], et reconnaissez que je suis Dieu’ », dit Shena Yoder, membre de la First Mennonite Church à Middlebury, (Indiana, États-Unis), originaire des Philippines. Elle aime prendre des photos de plantes qui sont généralement négligées. Photo : Shena Yoder](data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==)
Dans le contexte de la RDC, les églises chrétiennes en générale et les mennonites en particulier, ont une lourde responsabilité par rapport à la protection de la création. Les responsables chrétiens et les fidèles des églises locales doivent être davantage enseignées sur le thème de la sauvegarde de la création. Ils doivent aussi mener des actions concrètes allant dans le sens de sa protection. Les responsables ecclésiastiques doivent jouer leur rôle prophétique en interpellant les dirigeants politiques concernant les dégradations de l’environnement.
Le contexte de nos frères et sœurs du Nord est différent de celui du Sud. Toutefois, la lutte contre les dégradations de la création est une affaire commune. Car ses conséquences sont, non seulement locales, mais mondiales. C’est pourquoi, les expériences des frères du Nord peuvent servir aux frères du Sud qui sont les plus exposés aux méfaits de la détérioration de la création de Dieu.
Historiquement, les mennonites sont attachés au travail de la terre (cultiver et garder) ; les expériences des uns et des autres dans ce domaine peuvent renforcer nos liens de fraternité et de partage. Je souhaite qu’une commission dénommée ‘Développement et Sauvegarde de la Création’ soit créée au sein de la CMM pour mettre à jamais notre empreinte en tant que communauté de foi attachée aux enseignements du Christ.
‚ÄîKukedikila Ndunzi Muller est représentant provincial de la Communauté des Églises des Frères Mennonites à Kinshasa, enseignant au Centre Universitaire de Missiologie (Kinshasa), et doctorant en développement holistique.
Cet article est paru pour la première fois dans le numéro d’avril 2018 de Courier/Correo/Courrier.
Bibliographie sommaire
Dewitt, C.B., L’environnement et le chrétien (Quebec :Ed. la clairière). 1995
Douma, J., Bible et écologie (France : kerygma). 1991
RocheDieu, C., Les trésors de la Genèse (Geneve : Emma√ºs)
Roop, E.,F, Genesis, Believers church Bible commentary (Scottdale : Herald Press) 1987
Nzuzi, Lelo Kinshasa, ville et environnement (paris: harmattan). 2009
Katalamu, Mobi ’ protection durable de l’environnement’ (Kinshasa : CUM). 2016
Harimenshi, P.,B., ’ Mission et écologie’ (Kinshasa : CUM). 2002





![La Iglesia Menonita Fuente de Vida de Jac√≥ (Costa Rica), propose des ateliers gratuits o√π les enfants et les adultes font de l’artisanat à partir de matériaux recyclés. « Grâce à ces ateliers, nous essayons de sensibiliser le public à la protection de l’environnement dans le cadre de notre responsabilité [de chrétien] », dit la pasteure Sandra Campos. Photos : Sandra Campos](https://mwc-cmm.org/wp-content/uploads/2024/10/sandra_camps.jpg)

![« Cette photo me rappelle le Psaume 46:11 : ‘Arrêtez [cessez-immobilisez-vous], et reconnaissez que je suis Dieu’ », dit Shena Yoder, membre de la First Mennonite Church à Middlebury, (Indiana, États-Unis), originaire des Philippines. Elle aime prendre des photos de plantes qui sont généralement négligées. Photo : Shena Yoder](https://mwc-cmm.org/wp-content/uploads/2024/10/shenayoder-dandelion.jpg)